Cornélius
Quelque soit le festival, le stand des Editions Cornélius attire le regard. Nous avons envie de toucher, d’ouvrir ces livres et de s’imprégner de leur univers. Le livre Péplum, chef d’œuvre de Blutch, pourrait à lui seul symboliser l’importance du travail d’éditeur de Jean-Louis Sordhide. Ses couleurs, sa maquette font que l’objet-livre est parfaitement en résonance avec l’oeuvre de l’auteur. Une grande créativité et une exigence intraitable qui transpirent dans chaque collection imposent aujourd’hui les Éditions Cornélius comme un éditeur phare de la bande dessinée contemporaine.Editions Cornélius : Mon vrai nom est Jean-Louis Gauthey Sordhide. C’est juste ce qu’il faut de vieille France et d’aristocratie pour être crédible dans le milieu de l’Édition.
L’Indispensable : Crédibilité, vous l’avez tout de suite envisagé en faisant des livres exigeants au niveau éditorial ?
E. C. : L’exigence est effectivement un soucis pour la famille Cornélius et moi-même. Mais cette exigence n’est motivée par rien d’autre que par le plaisir de publier des livres que nous aimons. Il ne s’agit pas d’une tactique éditoriale visant à se distinguer des autres à tout prix. Que quelques livres de Cornélius puissent paraître difficiles d’accès à certains lecteurs n’est pas un choix délibéré, si c’était le cas, ce serait vouloir jouer au malin sur le dos des auteurs. Pas une once de cynisme ou de stratégie dans nos choix. Ce sont juste des goûts défendus de façon simple et directe par le biais de l’édition.
Simplicité et immédiateté, c’est d’ailleurs ce qui préside à la réalisation des maquettes et des couvertures. Eviter les fioritures et les chichis. Et mettre en valeur avant tout l’auteur et son travail. Les principes graphiques des couvertures nous identifient fortement mais restent très discrets, c’est pour cette raison que nous n’avons pas de logo, tout notre travail doit être digéré par le dessin.
L’I. : Comment se fait l’approche d’un livre et du travail avec un auteur ?
E. C. : Prenons par exemple Blutch. Le travail avec Blutch comme avec d’autres auteurs est basé pour une grande part sur de l’affectif. Ça ne sert à rien de vouloir simuler une espèce de professionnalisme qui passerait par une distinction faite entre l’affection que l’on a pour un auteur et le travail que l’on réalise avec lui.
C’est peut-être nécessaire dans le cadre d’une grosse maison d’édition, où les enjeux financiers sont différents. Mais dans une structure comme Cornélius, c’est du pipeau. Personne, ni les auteurs ni moi ne sommes là pour l’argent. Ce sont des opinions, des affinités ou des sympathies qui nous réunissent. Vouloir publier un auteur sous prétexte qu’il est vendeur ou qu’il a du talent, ce n’est pas suffisant. Il faut que l’on puisse bouffer avec lui, boire avec lui, être faible avec lui, se montrer sous un jour pas forcément idéal, et réciproquement.
J’ai pendant longtemps imaginé qu’il ne fallait pas mélanger travail et amitié. Et aujourd’hui, je pense exactement l’inverse. Je suis profondément convaincu qu’on ne peut éditer correctement que les auteurs avec lesquels on a noué des liens. Au risque même de s’engueuler et de se brouiller, parce que c’est délicat, compliqué et passionnel.
Je pense que dans le cadre d’une structure comme Cornélius, le travail s’effectue entre l’auteur et l’éditeur de façon très respectueuse, très partagée, et au bout du compte, de façon assez équilibrée. Chacun prend en compte les envies de l’autre, et au final, le livre ressemblera à deux personnes, et donc à personne d’autre. Les livres que Blutch a fait chez Cornélius, il ne les aurait pas faits ailleurs. Ce travail avec les auteurs m’apporte énormément sur un plan personnel. Je ne suis pas le même aujourd’hui qu’il y a cinq, lorsque les Editions Cornélius ont été créées.
L’I. : C’est finalement une réponse à la fois aux reproches que font les auteurs aux grands éditeurs en leur disant qu’il ne vendent jamais leurs livres et celui des éditeurs qui lancent aux auteurs : « Sans nous, vous n’êtes rien. »
E. C. : C’est en réponse à cette hypocrisie qu’on retrouve depuis l’origine de l’édition qui veut que l’auteur soit un grand artiste et l’éditeur un épicier. L’autre gros cliché toujours en cours est encore pire : c’est celui de l’éditeur Pygmalion qui découvre les auteurs comme on repère les truffes, le visionnaire qui tirent les génies du caniveau et les mène jusqu’au sommet après leur avoir fait prendre une douche… Comme si auteurs et éditeurs vivaient un antagonisme viscéral comparable à celui des chiens et chats ! C’est d’autant plus ridicule que l’édition, comme quantité d’autres secteurs, fonctionne sur la cooptation. On parle souvent de piston, mais c’est un mauvais terme. Je préfère celui de cooptation.
En ce qui me concerne, je ne travaille qu’avec des gens que je connais, soit directement, soit par rencontre. Cela peut être des amis qui me présentent une personne, dans un bar, au bowling ou à la plage, mais ce n’est que comme ça. Je ne pense pas avoir édité une seule fois un auteur dont j’ai reçu le manuscrit par la poste. Ce n’est pas intéressant. Si jamais je recevais un projet qui retenait mon attention, il faudrait que je rencontre le type et qu’on s’apprécie. Avant qu’il soit édité, il y aurait ainsi toute une relation qui se serait établie, une connaissance de l’autre, une confiance… Qu’est-ce que je raconte ? Bon sang, jamais j’aurai dû lire Le petit prince !
En tous cas, il est inutile de prétendre que l’édition est ouverte atout le monde, que n’importe qui peut débarquer là-dedans avec ses pantoufles, s’installer dans un fauteuil et se faire offrir un cigare parce qu’il est bon. Cela ne suffit pas d’être bon. Il faut d’abord connaître et se faire connaître. C’est normal. Il n’y a aucune honte à dire cela.
L’I. : Quel est pour vous le plus excitant dans la réalisation d’un livre ?
E. C. : Le plus excitant pour moi, dans le fait de faire un livre, c’est déjà d’être présent à tous les stades de sa fabrication, de le voir se faire et participer ainsi activement au livre jusque dans les aspects les moins gratifiants. Cela va du choix éditorial en passant par le suivi de l’auteur, la discussion avec lui, jusqu’à la réalisation en tant que telle.
La maquette est faite en interne. On choisit le papier. On fait les couleurs. On imprime les couvertures. La couverture pour moi, c’est un peu comme l’affiche, la page de garde dans les comix ou les trois coups au théâtre. Dans l’Alphabet Capone, les différents papiers qui sont utilisés déclinent la gamme de couleurs comme des levers de rideau successifs. Au bout du compte, le livre est vraiment la résultante du travail de l’auteur et de l’éditeur.
Jamais je n’ai publié un livre que l’on m’a amené tout fait. Je pense que c’est un des aspects qui intéresse les auteurs qui travaillent chez Cornélius. Ils savent qu’ils seront surpris, mais jamais trahis. Lorsqu’ils ont achevé leurs pages, ils reste à déterminer toute la présentation du livre. Elle s’impose parfois d’elle-même, mais rarement dans sa totalité.
Chez Cornélius nous essayons de bosser comme au théâtre. Eux sont les auteurs, et Cornélius est le metteur en scène. On discute beaucoup, ils ont des exigences, des envies, mais ils font confiance. Je suis toujours surpris par ce qu’ils apportent, alors j’essaie de leur offrir la même surprise que celle que j’ai quand je lis leurs pages. L’idéal serait qu’ils découvrent le livre en librairie, et qu’ils se disent : «ah, il est bien ce livre. Qui est-ce qui l’a fait ?»
Ce serait ça, l’idéal.
Avec Pierre La Police, sur son dernier livre, Nos meilleurs amis et l’acte interdit, c’est exactement ce qui s’est passé. Il avait déjà auto-édité ce livre quelques années plus tôt. Quand nous avons décidé de le rééditer, il était très occupé et n’avait pas de temps à consacrer à une nouvelle version. J’ai donc récupéré les documents et choisi d’autres dessins pour le compléter.
Puis j’ai refait la maquette, l’informant de temps en temps par téléphone de ce que j’étais en train de faire. Il se trouve qu’ensuite le livre a été mis en vente avant qu’il n’ait reçu ses exemplaires. Il l’a découvert en librairie. Ce qui peut paraître scandaleux. Mais il n’en a pas pris ombrage au contraire, ça lui a fait plaisir Il l’a même acheté !
Sachant que le livre a énormément changé entre les deux éditions, l’effet de surprise a été parfait. C’était pour lui, une émotion plus forte que si je le lui avais donné en mains propres. Il avait découvert son livre comme un lecteur.
L’I. : Vous êtes votre propre imprimeur ? C’est important ?
E. C. : C’est très important de mettre les mains dans l’encre parce que ça nous porte à plus d’exigence en même temps qu’à plus d’indulgence. On essaie de faire du mieux qu’on peut, mais on est parfaitement conscient, quand nous sous-traitons une partie du travail, de la complexité qu’il peut représenter. Et puis faire un travail manuel et salissant nous rappelle à des réalités très simples, comme par exemple que nous ne faisons pas partie d’une élite, ou que si nous sommes faillibles, les autres ont le droit de l’être aussi.
Dans tout livre, il y a des défauts. Les couleurs ne sont pas exactement celles que l’on voudrait, ou alors il y a des petits décalages… Ce n’est pas grave, l’important, c’est de savoir gérer ces défauts. Ce qui prime, c’est l’idée de la perfection. Pas d’atteindre la perfection mais d’en donner l’illusion.
Les défauts ne me dérangent pas, parce qu’ils peuvent être aussi touchants, aussi chargés d’émotion qu’un comédien qui un soir a un peu perdu de sa voix, ou qu’un micro dans le champ au cinéma. Un film peut être parfait même avec un micro dans le champ. Et à l’inverse, un film peut être techniquement sans le moindre défaut et complètement froid. Le fait d’imprimer les livres en interne, ça amène toutes ces erreurs, tous ces accidents qui, si la démarche est bonne à l’arrière-plan, rajoutent une émotion que chacun ressentira en manipulant le livre.
Ce que je dis là est aussi valable pour les auteurs de Cornélius. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit d’être moins bons. Ce qui ne signifie pas que je ne suis pas, critique et qu’il faut laisser quelqu’un se fourvoyer. Simplement, dans le cadre d’une oeuvre, les erreurs sont la preuve d’une recherche. Elles deviennent de ce fait intéressantes et respectables.
L’I. : Votre démarche éditoriale est très exigeante. Vous vous retrouvez dans un médium qui est tenu par les grands éditeurs avec une image de la bande dessinée très consensuelle, n’est-il pas trop difficile d’être éditeur dans ces conditions ? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre édition ?
E. C. : Par rapport aux gros éditeurs, je n’ai strictement aucun problème et je ne veux surtout pas véhiculer le discours — soit disant alternatif — qui serait de dire et d’affirmer haut et fort en bombant le torse que « les gros éditeurs, c’est de la merde, ils ne font rien, ils sont là pour faire du fric, il n’y a pas la moindre part de création chez eux » et qu’à l’opposé, les petits éditeurs underground seraient là pour débroussailler une espèce de mine incroyablement riche.
L’I. : Vous refusez le terme de label indépendant ?
E. C. : Bien sûr. Je ne suis pas indépendant, je suis petit. Je ne suis pas plus indépendant que Dargaud. J’ai aussi un banquier, j’ai aussi des tas d’emmerdements. Je pense que ce qui prédomine envers et contre tout, c’est le relationnel et la souplesse. Et puis l’argent, bien sûr. Ce sont les seules différences qu’il peut y avoir entre un petit et un gros éditeur. La communication et les expériences sont plus faciles chez un petit, mais il est quasiment impossible d’y faire fortune.
Sinon au bout du compte nous ne sommes pas très différents. Un livre, je le tire moins que Dargaud, les Humanoïdes ou Casterman, mais à une autre échelle, j’ai le même souci de rentabilité. Parce que si ce livre n’est pas rentable, derrière, je ne pourrai pas en faire d’autres.
Cornélius est peut-être plus petit mais c’est aussi sa force. On peut y prendre plus de risques. Les tirages ne sont pas très importants, mais nous touchons un public que nous connaissons. Nous savons combien ils sont, nous savons qu’ils vont nous suivre sur tel et tel livre.
Je trouve qu’il y a plein de bons albums chez les gros éditeurs. Il y a quantité de merdes aussi parce qu’ils font plus de livres que nous. Si demain Cornélius devait sortir quarante livres par an, il y aurait un certain pourcentage de merde parce qu’il n’y a pas quarante bons livres par an à faire chez Cornélius, comme il n’y a pas cent bons livres à faire chaque année chez Dargaud.
Je voudrais sortir de cet espèce de schématisme qui voudrait qu’il y ait les bons et les méchants, les purs et les salauds. Je me méfie de ce discours, il est trop souvent véhiculé par des «rebelles» qui crachent sur le bourgeois en rêvant de gagner au loto pour s’acheter une Mercedes. Pour moi, il y a juste des gens qui font des choses auxquelles j’adhère ou pas.
J’aime l’idée qu’un marché parallèle existe, j’aime cette qualité d’autonomie des petits éditeurs, et j’aime par-dessus tout le fait que nous ayons réussi à prouver que nous avions un rôle à jouer face aux gros éditeurs. Mais en aucun cas je ne considère ces derniers comme des adversaires ou des concurrents. D’une part parce que ce serait stérile et disproportionné. Et d’autre part parce que nous ne remplissons pas le même fonction. C’est d’ailleurs pourquoi je peux affirmer que Cornélius saura refuser de grossir à moment donné.
Le point faible de la micro édition est qu’il est quasiment impossible d’en vivre. Il faut donc avoir peu de besoins ou d’autres sources de revenus. Il n’y a pas le système de l’office, il y a donc une trésorerie très fluctuante qui fait que c’est une forme d’absolutisme et d’abnégation. Mais je continue à penser et à croire que la richesse que cela amène vaut largement un gros chèque à la fin du mois.
A côté de ça, il faut se fixer des objectifs et se dire : « Combien de temps vais-je pouvoir tenir en acceptant de gagner peu ou pas d’argent ? »
Imprimer en interne est une des solutions que nous avons trouvée pour consolider la structure de Cornélius et faire que sans être une machine à fric, elle puisse subvenir aux salaires des personnes qui y travaillent. Cette possibilité d’expérience et de liberté qui existe au sein de Cornélius pour les auteurs doit aussi pouvoir s’appliquer aux gens qui en sont salariés. Chacun organise son temps et son travail comme il l’entend, avec pour seule obligation de générer son propre salaire. Ce qui laisse libre cours à toutes sortes de projets.
L’idéal serait de pouvoir appliquer ce principe à toutes les personnes avec lesquelles nous souhaiterions travailler… Mais je ne pense pas que cela soit une utopie.
Propos recueillis par Bruno Canard.
Précédemment publiés dans L’Indispensable n°1 en Juin 1998.
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée





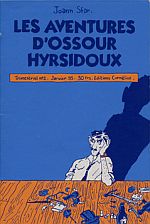


















An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster