Le Dessin dans l’écriture
«Dans un tableau, les mots sont de la même substance que les images.» C’est l’une des réflexions que se fit Magritte, dans un article peu connu de 1929, «Les mots et les images».[1] Leçon qui pourrait s’appliquer sans paraphrase à la bande dessinée. La coprésence du texte et de l’image est chose courante chez le peintre de la Trahison des images.[2] C’est aussi le cas, par exemple, chez Miró, qui aura accompagné une tache bleue d’un «Ceci est la couleur de mes rêves».[3] Ici et là le geste calligraphique a son importance. Chez Magritte, la phrase fameuse «Ceci n’est pas une pipe» est doctement rédigée, à la manière d’un tableau d’école. Chez Miró les lettres, également attachées, deviennent stylisées, dansent, gagnent du corps à la manière d’une affiche. Dans les deux cas la calligraphie interprète le texte au plus juste : ironiquement ou lyriquement, selon le besoin.
La calligraphie, on le voit, a deux fonctions qui la lient de manière intime à l’image qu’elle accompagne : par son style, elle poursuit la rhétorique de l’image ; par son geste, elle prolonge l’esthétique de l’œuvre. L’écriture, en d’autres mots, est en partie un dessin ou plus exactement, il y a une part de dessin dans toute écriture. C’est cette part qu’il convient d’examiner aujourd’hui.
De quelques pattes remarquables
Car la bande dessinée est en grande partie un art calligraphique. Il suffit de parcourir son histoire pour découvrir un ensemble de manières, de pattes, de façons d’écrire hautement reconnaissables, y compris dans leur maladresse. On a déjà remarqué, par exemple, l’étonnante disparité entre la géométrie si précise d’un Winsor McCay et ses bulles souvent trop petites, son écriture à peine lisible. La règle veut pourtant qu’il y ait une complicité naturelle entre dessin et calligraphie. Nulle disparité donc chez Franquin, Schulz, Herriman, Macherot (pour n’en nommer que d’évidents). Non plus chez un Francis Masse, dont la nausée de détails est confirmée par une écriture extrêmement tassée, qui trébuche dans ses empattements. Ou chez un Ben Jones, dont le style calligraphique si singulier correspond sans peine à des choix graphiques tout aussi peu explicables. On ajoutera que chez Sfar, l’écriture est tout aussi peu fixée que le dessin ; que chez Trondheim, la lisibilité du texte va de pair avec une rapidité évidente dans l’exécution, laissant de sorte lire en filigrane la visée éthique de l’auteur. Même discrète, la calligraphie est un miroir terriblement perçant et il est notable que chez certains jeunes auteurs, émules réticents de la «nouvelle vague», l’écriture devient une chose codée, trop lisse, trop mécanique pour être honnête.
La question de l’écriture dans la bande dessinée se pose aujourd’hui de deux manières distinctes mais rapprochées. D’abord parce que, de plus en plus, des auteurs choisissent de composer leur texte à l’ordinateur et ce pour diverses raisons : soit leur calligraphie est illisible ou peu avenante ; soit ils sont paresseux ou simplement encouragés par leur éditeur ; soit ils dessinent déjà à l’ordinateur (à la tablette graphique ou autrement). D’autre part parce que la traduction de la bande dessinée appelle le plus souvent, pour des raisons platement économiques, un type de solution mécanisée. D’une manière ou d’une autre, mon but ici n’est pas de condamner l’utilisation de moyens mécaniques.
Je note tout de même d’abord que, longtemps avant l’avènement du Photoshop, il arrivait qu’une tierce personne — appelée en anglais letterer, «lettreur» — rédige les textes à la place du dessinateur. Ici on pense tout naturellement à la bande dessinée superhéroïque états-unienne, où cette pratique est généralisée depuis longtemps, mais il est utile de savoir que les livres de Tardi furent d’abord «lettrés» par Anne Delobel, à qui l’on doit également la calligraphie de maints ouvrages parus chez Casterman, notamment de Forest, Muñoz ou Altan. Anne Delobel est un cas remarquable car, pour chaque artiste, elle crée, pour ainsi dire, une calligraphie qui leur est propre. C’est donc dire que, lorsque Fantagraphics annonce avoir créé une «police Tardi» pour ses récentes traductions, c’est en fait d’une police Delobel qu’il est question. Mais ici je touche déjà aux traductions : j’en profite pour rappeler cette anecdote amusante : à l’époque de la revue Raw, on voulut éditer Masse en anglais pour la première fois. C’est à Paul Karasik qu’on demanda de «lettrer» la traduction, ce qu’il fit avec beaucoup de labeur (on s’en doute) et en recommençant par deux fois. Ces efforts ne furent pas vains : Karasik put ensuite clamer qu’il était la seule personne au monde à savoir écrire comme Masse. Talent inédit qu’il n’eut plus jamais l’occasion d’utiliser.
Dans les faits, il n’est jamais nécessaire que le traducteur imite à la perfection la calligraphie de son modèle : il suffit que le geste soit apparenté. La patte de Jimmy Beaulieu, par exemple, n’est pas celle de Jules Feiffer ; mais, dans la version française de Tantrum,[4] le dessin de l’un et l’écriture de l’autre se marient harmonieusement et sans cérémonie. Il est probable que pour obtenir l’imitation parfaite il eût fallu sacrifier la force du geste, si importante chez Feiffer. Mais on sait aussi que pour Jimmy Beaulieu Tantrum est une œuvre qui touche à l’intimité de sa propre démarche artistique, et c’est en partie cette affinité au texte qui lui permet de le «jouer» si justement. Car c’est bien de jeu qu’il s’agit ici, ou plus précisément : d’interprétation.
De l’usage correct de Comic Sans
Je prends maintenant un cas inverse : une écriture en parfaite inadéquation avec le propos du livre : la version française de L’homme sans talent de Tsuge Yoshiharu. Ce livre est reconnu comme un classique du watakushi-manga, autrement dit la «bande dessinée du moi» pour reprendre l’expression proposée en préface du livre. Ce récit lent, impitoyable envers son auteur-protagoniste, se veut un regard brut et malaisé sur la vie d’un homme dégoûté de son art et incapable d’entreprendre quoi que ce soit d’autre. Chaque parole devrait participer à son apitoiement. Chaque instance de narration devrait faire partager son mal-être. Devrait ? Oui, parce qu’en fin de compte, il est très difficile de prendre au sérieux un livre qui comme celui-ci est composé dans son entièreté, et sans la moindre ironie, en Comic Sans.
Comic Sans est une police inventée au milieu des années 1990 par un certain Vincent Connare.[5] Elle fut popularisée par le fabricant de logiciels Microsoft, qui l’intégra dans son système d’exploitation Windows 95. Sa particularité est que, comme son nom l’indique, elle imite un style de calligraphie de «comics», ou du moins se donne comme telle (il n’est pas certain que cette police soit basée sur une calligraphie réelle, on dirait plutôt une synthèse de clichés calligraphiques). Et comme elle fait aujourd’hui partie de l’installation de base des deux principaux systèmes d’exploitation domestiques (Windows et Mac OS), son utilisation est aujourd’hui répandue sur la planète entière. Son concepteur la voyait servant à des fins purement ludiques : messages d’assistance délivrés dans une bulle, logiciels pour enfants, etc. Seul problème, tout le monde s’est mis à l’utiliser pour un peu n’importe quoi. On vit apparaître, sans crier gare, mémoires, rapports médicaux et annonces de décès composés en Comic Sans. Si on ajoute que l’irrégularité de cette police rend pénible la lecture de n’importe quel texte dépassant le court paragraphe, on peut comprendre que, pour les graphistes du monde entier, Comic Sans soit devenue une sorte de némésis, l’ultime icône du mauvais goût typographique.
Admettons que Comic Sans n’est pas, en soi, une abomination et que le problème en est d’abord un de connotation. Comic Sans n’a jamais demandé à être prise au sérieux ; c’est une typographie informelle et, en ce sens, rigoureusement démocratique. En l’occurence, ce problème de connotation est bien ce qui pèche dans la version française de l’Homme sans talent : comment concilier la sobriété du récit avec une composition typographique qui se donne d’emblée comme extrovertie, consensuelle, enfantine ?
Le problème rencontré par Kaoru Sekizumi et Frédéric Boilet, cités comme traducteurs et adaptateurs graphiques de l’ouvrage, est réel : comment traduire les idéogrammes japonais dans notre alphabet ? Lorsqu’il s’agit de bande dessinée en anglais, en néerlandais, en espagnol, on peut s’inspirer de la calligraphie originale, du moins préserver son esprit. Mais il s’agit alors du même alphabet. Pour le cyrillique (le russe et consorts), ça peut encore passer. Mais le japonais, le mandarin, le cantonais, le coréen, l’arabe, l’hébreu utilisent tous, est-il besoin de le souligner, des systèmes graphiques fort différents du nôtre. Toute idée d’«adaptation» calligraphique devient dès lors un non-sens et il vaut mieux alors reprendre le travail à zéro. D’où cette question inévitable de la typographie à utiliser.
Cette question de justesse typographique se pose différemment pour chaque œuvre. Je pense par exemple aux livres de Mizuno Junko publiés chez Imho, dans lesquels le même Comic Sans sert sans véritable accroc un propos à la fois hautement parodique et une esthétique faussement enfantine. Certes, il s’agit d’une utilisation ironique ; elle n’en est pas moins appropriée. Ou, pour dire comme le typographe français Jean-François Porchez : «Le problème n’est pas le Comic Sans, mais l’usage qui en est fait.»[6]
Périls de la pseudo-calligraphie
La plupart des adaptations du japonais ne sont pas aussi heureuses, même lorsqu’elles évitent le Comic Sans : on y utilise le plus souvent sans trop de réflexion une typographie vaguement inspirée du lettrage des comics américains et ce grand écart culturel ne semble pas déranger outre mesure les éditeurs. Cette confiance démesurée dans ce que j’appellerai la pseudo-calligraphie touche ici ses limites, notamment dans un livre comme le Samouraï bambou de Matsumoto Taiyô. Ici, le dessin a été consciemment et consciencieusement réduit à une gestuelle très classique, rappelant Hokusai et le dessin médiéval japonais : une approche où dessin et écriture montrent leur profonde affinité. La version française ignore cette inséparabilité, remplace les idéogrammes par une pseudo-calligraphie banalisée et au final très peu japonaise. Entendons-nous, il eût été tout aussi malvenu de donner dans ces fontes «orientalisées», calques mensongers d’une certaine façon de tourner l’écriture, qui n’en gardent que le signifiant «exotique», c’est-à-dire tout sauf exotique. Il reste que la gestuelle si particulière de Matsumoto se voit violemment châtrée par ce simulacre de geste qui sert ici de texte. Il aurait fallu être inventif, confronter le dessin par le dessin. À la place, le lecteur décroche : c’est comme si on regardait un film avec les sous-titres mais sans la bande sonore.
Les pseudo-calligraphies réussies répondent à certaines conditions très précises. D’abord, elles sont adaptées à l’œuvre. Je mentionnais plus haut la police créée par Fantagraphics pour l’adaptation anglaise des livres de Tardi. Il s’agit en fait de deux polices, l’une pour ses œuvres plus anciennes (à l’écriture à la fois plus fine et plus serrée), l’autre pour les récentes. Mais la calligraphie «tardienne» (ou delobelienne, c’est selon) a un aspect plutôt régulier, qui se prête assez bien à une adaptation mécanique. Toute autre est la patte de Sfar, que l’éditeur états-unien First Second a eu la très mauvaise idée de remplacer par une police de type script à la fois trop différente de l’écriture originale et trop régulière pour remplir fluidement les bulles et autres espaces de narration. Tout aussi malvenues : les adaptations de Donjon pour l’éditeur NBM, qui utilisent une police encore là faussement calligraphique, qui plus est sans aucun rapport avec l’écriture des auteurs.
Le problème de la pseudo-calligraphie repose sur un principe assez simple, exposé par Robert Bringhurst dans son Elements of Typographic Style : «La typographie n’est que cela : une idéalisation de l’écriture.»[7] En d’autres mots, il ne suffit pas, pour créer une police, de copier servilement n’importe quel alphabet manuscrit, il faut idéaliser cet alphabet, c’est-à-dire lui trouver une logique graphique, une règle, une forme qui transcende chaque caractère individuel pour lui donner sa place au sein d’un tout unifié. La typographie, en outre, est quelque chose qui paradoxalement doit se faire oublier tout en enrichissant le texte de sa présence : art bien délicat que celui-là, proche en ce sens de l’architecture.
Plus simplement : une pseudo-calligraphie mal faite montre davantage son côté pseudo que son côté calligraphique. Son état factice émerge de l’écriture et en parasite la signification. Nous entrons alors dans l’uncanny valley, cet entre-deux connu des cybernéticiens où l’imitation n’est ni assez fidèle, ni assez grossière et pour cette raison provoque le malaise.
Et maintenant : quelques solutions typographiques
Il est pourtant possible d’utiliser la typographie informatique d’une manière harmonieuse. Il suffit parfois de rechercher, non la police qui imiterait une main humaine, mais plutôt celle qui prolongerait le mieux le discours et l’esthétique du dessin. Prenons par exemple Achewood de Chris Onstad, excellent strip dont le style graphique laisse penser qu’il fut réalisé entièrement à l’ordinateur. La police utilisée dans les bulles est une variation de la célèbre Highway Gothic, qui ornait jusqu’à récemment tous les panneaux routiers d’Amérique du Nord.[8] Cette sans sérif[9] a l’avantage d’être hautement lisible, plutôt neutre ; mais c’est sa connotation à la fois fonctionnelle et plaisamment vernaculaire qui donne le change. L’auteur, en outre, joue avec sa typographie : le personnage de Roast Beef, par exemple, «parle» un point ou deux plus petit que les autres (et n’utilise jamais de ponctuation). Tel autre personnage s’exprime uniquement en majuscules, etc. On retrouve ici, dans une moindre mesure, la fantaisie qu’à une autre époque Walt Kelly exerçait dans son strip satirique Pogo, dans lequel certains personnages s’exprimaient dans des calligraphies particulières, ce qui dénotait et exacerbait tel aspect de leur personnalité ; fantaisie reprise à l’excès dans le récent Asterios Polyp de David Mazzuchelli. De même, aussi, Astérix chez les Goths — mais nous sommes ici davantage dans le gag pur, et la connotation fournie par l’écriture de style gothique s’applique là à tout un peuple, pas seulement à tel ou tel individu particulier.
Autre exemple parlant : les adaptations françaises de Yokoyama Yûichi parues aux éditions Matière, par exemple Travaux publics. Peu de texte à traduire ici, mais le peu qui s’y trouve est composé dans une italique sans sérif d’allure postmoderne, très géométrique (non identifiée de moi), répondant parfaitement à l’esthétique quasi abstraite de l’ensemble. On remarquera au demeurant l’excellence de la mise en page dans le reste du livre, page titre comprise : j’en retiens que nous sommes en présence d’un graphiste qui sait ce qu’il fait, de bout en bout.
L’utilisation d’une typographie n’empêche pas le retour à l’écriture manuscrite. Serge Huo-Chao-Si, dans sa Grippe coloniale, calque ostensiblement au crayon une sérif romaine (une Garamond ou une Caslon, peut-être), ce qui donne au texte un aspect à la fois mécanique et dessiné. L’ensemble est très harmonieux, notamment le relatif classicisme de l’écriture choisie, son aspect «littéraire» et humaniste, qui n’est pas sans déparer par rapport à l’époque dans laquelle se déroule l’histoire, soit la fin de la Seconde Guerre. Comparons cela avec l’exemple déjà cité du Samouraï bambou où la pseudo-calligraphie de comic book fait mentir toutes les précautions du dessin situant fermement le récit dans le Japon médiéval.
La typographie, cette grande oubliée
À leur décharge, les éditeurs occidentaux ont pour eux un fait presque contrariant : les livres japonais sont en grande partie composés mécaniquement : on n’y trouve que très rarement, comme en Europe, l’écriture manuscrite. Oui, mais justement. Cette typographie n’essaie pas d’imiter la main de l’auteur, elle interprète simplement le texte au mieux. Dans la version originale du Samouraï bambou, pour reprendre cet exemple, ce rôle échoit à une sans sérif japonaise ronde, douce et très discrète. La fonte occidentale correspondante aurait dû répondre à peu de choses près à ces caractéristiques : une Scala Sans, par exemple.[10]
Robert Bringhurst, toujours dans ses Elements, rappelle cette règle qui devrait également s’appliquer à tous les typographes en herbe de la bande dessinée : «La typographie sert à honorer un contenu.»[11] En d’autres mots : celui qui place le texte dans une bulle, dans un espace de narration, doit être conscient de l’effet que génère la forme même du texte, ainsi que de la signification que cette forme ajoute, qu’on le veuille ou non, au texte. Cette signification ajoutée n’est pas aussi subliminale qu’on voudrait le croire, seulement, le lecteur n’a pas toujours les moyens de mettre le doigt dessus, la typographie étant par essence un art de la discrétion.
Il est bizarre que, même chez des éditeurs aussi consciencieux qu’ego comme x ou Cornélius (NonNonBâ, autre fameuse victime du Comic Sans), soucieux de publier un livre japonais dans le sens de lecture oriental, allant jusqu’à «sur-titrer» les onomatopées afin de conserver leur aspect graphique original, aient pourtant abandonné l’interprétation du texte à des pis-aller typographiques parfaitement bancals. Car il s’agit bien ici de trouver la voix du texte et même des personnages eux-mêmes. La traduction est une trahison, dit-on : ajoutons qu’interpréter cette traduction dans une police mésadaptée relève, en fin de compte, d’une trahison supplémentaire.[12]
Comprenons donc bien ceci, l’ordinateur n’est pas l’ennemi et, on l’a vu, on peut très bien concevoir un lettrage mécanique qui soit à la fois élégant et respectueux du texte. Mais pour cela il faut investir l’espace graphique de l’écriture avec la même force, la même pertinence, la même intelligence que l’auteur pour son dessin. Ceci parce que peu importe sa forme, calligraphiée ou mécanique, l’écriture est un dessin : en cela elle participe autant que la figuration à la pleine lecture d’une œuvre de bande dessinée. La main n’est qu’une machine parmi d’autres : ce qui compte c’est l’artiste qui est au bout. On l’oublie à ses risques et périls.
Notes
- René Magritte, «Les mots et les images», dans la Révolution surréaliste, no 12, 1929, p. 32. Reproduit dans Anne-Marie Christin, l’Image écrite ou la déraison graphique, Flammarion, coll. «Champs arts», 2009, p. 412.
- René Magritte, «La trahison des images», 1928-29, huile sur canevas, 65,3 x 93,98 cm. Los Angeles County Museum of Art.
- Joán Miró, «Photo — ceci est la couleur de mes rêves», 1925, huile sur canevas, 96,5 x 129,5 cm. Collection privée.
- Livre que j’ai moi-même traduit en collaboration avec Josiane Robidas, je le souligne par acquit de conscience.
- Ce n’est pas drôle.
- Laetitia Taurand, «A While with Jean-François Porchez», Pica n°1, École de design UQAM, 2009.
- Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, version 3.1, Hartley & Marks, 2005, p. 19. Ma traduction.
- Cette police est aujourd’hui progressivement remplacée par une autre, nommée ClearviewHwy, réputée plus visible à de longues distances.
- Le sérif est l’empattement que l’on retrouve sur plusieurs lettres, par exemple les pattes d’un m. Une typographie sans sérif — par exemple l’Arial qu’utilise présentement du9 — ne présente pas ces caractéristiques.
- Autre défaut de la pseudo-calligraphie de style comic book : celle-ci s’étend le plus souvent sur un axe horizontal, ce qui est une contradiction à l’intérieur de bulles le plus souvent conçues à la verticale. Une adaptation en langue occidentale devrait plutôt favoriser une police condensée, plus à même d’habiter confortablement ces espaces pour nous exigus.
- Robert Bringhurst, op. cit., p. 17. Ma traduction.
- Le plus bizarre, dans le cas de Cornélius, est que l’éditeur a démontré une toute autre sensibilité dans l’adaptation, fort réussie, du Cornigule de Kurihara Tahashi.
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée




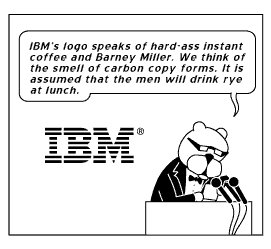


















An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster