Taniguchi Jirô
Avant-propos : L’oeuvre de Jirô Taniguchi, dessinateur unique, inclassable au sein de la bande dessinée japonaise, est impossible à saisir dans sa globalité depuis la France, au vu des seules traductions de L’Homme qui marche et du Chien Blanco. Ce qui définit au premier chef l’oeuvre de Taniguchi, et lui donne son statut unique dans le monde de la manga, c’est sa diversité.
Alors que la majorité des dessinateurs se trouvent d’emblée condamnés à faire toute leur carrière dans le genre très précis qui les a révélés, Taniguchi multiplie les expériences et revisite en passant bon nombre de registres classiques de la manga : si ses premières créations mettent déjà en scène la confrontation entre l’homme et la nature, accordant déjà une place centrale aux animaux sauvages, il oeuvre également dans les genres policiers (plusieurs titres « hard boiled » en collaboration avec Natsuo Sekikawa), et de science-fiction (les deux volumes de Chikyû hyôkai jiki/Chronique du dégel terrestre, de 89 à 92), se lance dans l’adaptation de romans historiques (Kaze no shô en 1992) et l’épopée sportive (la vie d’alpinistes à l’assaut des grands sommets avec K en 1987, et auparavant la discipline classique qu’est la boxe, avec Ao no senshi, Live odyssey…), se consacre pendant dix ans à un monumental panorama de la littérature japonaise moderne naissante (la « pentalogie » de Botchan no jidai/Au temps de Botchan).
Conséquence de cette foisonnante diversité thématique, ses collaborations extrêmement nombreuses lui font côtoyer les scénaristes et auteurs originaux les plus variés. Mais là encore, alors que les dessinateurs qui travaillent en collaboration avec un scénariste se limitent systématiquement à l’aspect graphique de leurs bandes dessinées, il se singularise en publiant seul un certain nombre d’albums, ses oeuvres les plus personnelles.
Les travaux de Taniguchi s’organisent selon une hiérarchie qui va des produits de commande, gekiga basiques comme les Samurai non grata, Enemigo, Rude boy ou Knuckle wars, jusqu’à ses oeuvres les plus achevées. De même, ses créations vont des récits les plus brefs (il a publié bon nombre de recueils d’histoires courtes, et ce depuis ses débuts) aux cycles les plus imposants.
Parmi ses oeuvres les plus marquantes, citons Chichi no koyomï (Le journal de mon père), récit à caractère biographique ayant pour cadre sa ville natale de Tottori. À la mort de son père, le personnage principal regagne sa province natale et retrouve un passé longtemps enfoui, dont il va peu à peu comprendre le sens. Ce récit en douze chapitres, prépublié d’avril à octobre 1994 dans le bimensuel Big Comic des éditions Shôgakukan, est dans la même veine intimiste que L’Homme qui marche.
Inu o kau, qui conte sur le même registre graphique et narratif la dernière année de vie d’un chien, est rythmé par la vie qui s’estompe doucement, et repose là encore sur l’expérience la plus personnelle de l’auteur. Le récit, récompensé en 1992 par le prix spécial du jury au 37e Grand Prix de bande dessinée des éditions Shôgakukan, trouvera suite dans quelques chapitres postérieurs.
Le trait de Taniguchi change selon les oeuvres et les genres qu’il explore. Son dernier volume paru, Kodoku no gurume (Le Gourmet solitaire), met en scène les tribulations gastronomiques d’un unique personnage, qui teste un plat précis dans un restaurant différent à chaque chapitre…
Dernière caractéristique de cet auteur à chaque fois plus surprenant, le nombre impressionnant des éditeurs qui l’ont publié ou le publient encore — ils se comptent par dizaines — au point qu’il peut affirmer en plaisantant que seuls un ou deux éditeurs lui résistent encore… En ce moment, tout en poursuivant la publication d’Icare dans Morning, l’hebdomadaire de Kôdansha, il vient de publier un récit dans le numéro de nouvel an du magazine concurrent Big Comic des éditions Shôgakukan.
(L’indispensable n°0 — Février 1998)
Jirô Taniguchi : Je suis né en 1947 à Tottori. Les mangas m’ont toujours intéressé. Enfant, je dessinais des personnages en les recopiant simplement sur des modèles que je trouvais dans des revues de bandes dessinées japonaises… En 1962, l’apparition des kashihon-ya gekiga[1] , qui devaient par la suite devenir les seinen manga[2] , fut pour moi un véritable événement. Je fus marqué par le réalisme des dessins et des expressions. Quant aux récits, ils y étaient traités de façon tout à fait nouvelle. J’avais 15 ou 16 ans à l’époque, et j’étais déjà très influencé par des auteurs tels que Takao Saitô ou Hiroshi Hirata…
À la fin de mes études, dès ma sortie du lycée, j’ai commencé à travailler. Mais la vie de salarié ne m’emballait guère et j’ai fini par démissionner pour monter à Tokyo et y devenir dessinateur-assistant d’un mangaka[3] du nom de Kyûta Ishikawa. J’ai travaillé 6 ans chez lui, c’est là que j’ai appris toutes les techniques de mon futur métier. Je suis devenu dessinateur indépendant en 1972, et le suis toujours actuellement.
L’Indispensable : Avez-vous à votre tour des assistants autour de vous ?
J.T. : Je possède effectivement un studio et travaille généralement entouré de trois assistants…
I. : La manga ne semble pas sujette à l’existence d’« écoles » ou de styles graphiques, comme en connaît la bande dessinée européenne.
J.T. : C’est vrai que les différences de styles ne sont pas aussi tranchées, et beaucoup de dessins se ressemblent. Il est dommage que nombre d’auteurs se contentent de suivre les courants et la mode, leur ambition se limitant à imiter les mangas qui ont connu un grand succès commercial. Certes, ces styles de dessins répondent à une certaine attente des lecteurs, mais je ne crois pas que dans cette voie, il soit encore possible pour nous de progresser, de faire évoluer notre propre système d’expression.
I. : L ‘acte de dessiner relève t-il pour vous du naturel, ou d’une forme d’autodiscipline ?
J.T. : Comme je l’ai déjà indiqué, les mangas m’intéressent depuis mon enfance. J’en ai beaucoup lu et bien sûr beaucoup dessiné. J’ai acquis les bases lorsque j’étais assistant, et il ne me reste aujourd’hui que la pratique pour parfaire mon apprentissage. Je réfléchis beaucoup avant de dessiner. Je pense que l’expression de la manga japonaise se situe entre celle du cinéma et celle du roman. C’est pourquoi, si vous voulez créer une manga qui vous soit personnelle, sur le long terme, il faut savoir que cela vous sera très difficile, à moins que vous ne sachiez apprendre de toutes choses et vous les approprier.
I. : Avez-vous des tabous graphiques ?
J.T. : Pour l’instant je n’ai pas de tabous en dessinant, bien qu’au Japon certains règlements municipaux interdisent la représentation des sexes dans l’acte sexuel. Dans ces cas-là, je m’efforce d’employer des moyens de représentation qui stimulent l’imagination des lecteurs, et je ne me suis, de cette façon, jamais senti limité.
I. : Votre première manga publiée en France est L’Homme qui marche. On y retrouve ce sentiment de la fragilité des choses — le «mono no’awaresi» cher à Yasunari Kawabata. Cet auteur a t-il influencé votre travail ?
J.T. : J’ai effectivement lu quelques livres de Kawabata quand j’étais au lycée, mais c’est un peu loin et je ne m’en souviens plus très bien. Il est sans doute vrai que je suis inconsciemment influencé par cette littérature japonaise que je lis depuis mon enfance. Cependant, je n’ai aucunement l’intention de transposer les particularités de l’expression littéraire dans mes ouvrages. Je suis bien plus intéressé par chercher des possibilités nouvelles, propres à la manga.
I. : Le rythme narratif de L’Homme qui marche rappelle également — et respectueusement — celui qui habite l’oeuvre d’Ozu…
J.T. : J’admets tout à fait avoir été conscient des films de ce cinéaste pendant que je me préparais à dessiner cet ouvrage, j’ai voulu introduire l’ambiance de ses films dans mes images. Je me suis demandé si, quelque part dans la vie trépidante et quotidienne du Japon, il n’existait pas quelque chose de précieux qui nous aurait échappé ou que nous aurions oublié. Et je me suis mis à marcher lentement à sa recherche… C’est ainsi qu’est né L’Homme qui marche.
Cela n’apparaît pas dans le récit, mais lorsque j’ai créé ce personnage, je lui ai imaginé un emploi dans un cabinet d’architecte. J’ai finalement occulté son quotidien de salarié pour ne montrer que ses moments de repos, de détente, sa vie en dehors du travail et du stress qui en découle. J’ai voulu en faire une personne calme, positive et que la solitude ne dérange pas. Un jour de congé, il s’arrête au bord de la route pour regarder un caillou quelconque, qu’il trouve beau ou intéressant. Le temps s’écoule alors doucement autour de lui…
J’ai cherché à replacer la vie de l’homme moderne dans le courant de la nature. J’ai également tenté d’exprimer des sensations simples comme « beau » ou « agréable », non dans les propos des personnages, mais au travers des dessins eux-mêmes. Je crois que L’Homme qui marche a élargi mes propres possibilités d’expressions dans le domaine de la manga. C’est ma première oeuvre expérimentale.
I. : S’inspire t-elle d’un modèle existant ?
J.T. : Il n’y a pas de modèle précis en ce qui le concerne. Mais il est probable que le personnage s’appuie sur mes propres rêves, mes propres espoirs… Le quartier où il réside existe réellement. J’ai effectué de nombreux repérages extérieurs pour ses histoires.
I. : La société japonaise — l’image que nous en avons — est fondée autour des notions de groupe et de famille. Or, le couple de L’Homme qui marche semble isolé socialement…
J.T. : Dans le Japon actuel — et surtout en ville — il y a de plus en plus de familles nucléaires. Les familles à trois générations qui cohabitent sous un même toit, comme autrefois ne sont plus aussi fréquentes. Les Japonais ont sans doute été influencés par les pensées occidentales et l’individualisme qui en découle. Par exemple : il existe aujourd’hui un nombre croissant de jeunes couples sans enfant. Je ne porterai pas de jugement personnel sur ce fait de société ; mais il est peut-être bon de préciser que le couple de L’Homme qui marche n’est pas un cas à part. Je n’ai en rien raconté l’histoire d’une famille marginale au sein de la société japonaise. C’est une situation courante, que l’on ne peut ignorer si l’on veut décrire avec justesse et vivacité le Japon contemporain.
Mais il est vrai cependant que cette manga décrit simplement une partie de la vie quotidienne, c’est un axe narratif volontaire. Certaines critiques ont jugé le thème trop sentimental, d’autres ont dit que le récit était inexistant… C’est précisément ce que j’ai cherché à réussir : en respectant ces aspects dans ma narration, j’ai voulu aboutir à un livre qui n’avait jamais été fait dans la bande dessinée japonaise.
I. : Vous célébrez la beauté de la simplicité, de l’instant, un respect quasi-cérémonieux de la vie…
J.T. : Je suis bouddhiste et m’intéresse plus particulièrement à l’un des principes enseignés par Bouddha que l’on appelle mikkyô[4] . Cette doctrine propose une vision profonde de l’uni vers. Elle met en évidence l’emprise des désirs sur l’homme et nous enseigne que l’important, pour mener à bien notre existence, réside dans le principe essentiel de la « vertu ».
I. : Envisagez-vous de réaliser d’autres manga avec le même personnage ?
J.T. : J’aimerais bien le faire, mais n’ai pas de projet pour l’instant.
I. : Dans toute votre oeuvre, L’Homme qui marche semble tenir une place importante à vos yeux…
J.T. : Chacune de mes oeuvres est si chère à mon cœur qu’il m’est difficile d’en préférer une… Si je devais le faire, je choisirais effectivement L’Homme qui marche. Puis, par la suite, Botchan no jidai[5] , Le Chien Blanco et Chichi no koyomi[6] . J’ai toujours travaillé afin d’atteindre un niveau plus élevé à chacune de mes réalisations.
I. : Vous avez eu un premier contact avec le public français lors du salon d’Angoulême en 199l…
J.T. : Je n’ai pas eu beaucoup de contacts avec des lecteurs, lors de cette première rencontre, pour la simple raison qu’à cette époque mes albums n’étaient pas encore traduits. Avant que L’Homme qui marche ne soit publié chez Casterman quelques épisodes en avaient été traduits dans les pages de la revue espagnole El Vibora. Elles y furent appréciées car elles montraient qu’il existait au Japon — et encore aujourd’hui — des mangas poétiques, paisibles. Il est fort probable que les éditions Casterman les ont appréciées pour les mêmes raisons… Casterman contacta la maison d’édition Kôdansha et c’est ainsi que je me suis retrouvé traduit et diffusé en France.
I : Que pensez-vous des levées de bouclier médiatiques qu’a connu et connaît encore la manga en France ?
J.T. : N’est-ce pas la même chose pour tout nouveau moyen d’expression ? C’est un acte courageux que d’accepter quelque chose de nouveau et d’inconnu : en leur temps, roman et cinéma ont bien dû subir le même genre d’attaque…
Mais le problème de la manga réside peut-être dans son accès facile à l’égard des enfants. Je ne connais pas bien celles qui furent critiquées dans votre pays, mais je me demande si le malentendu ne vient pas avant tout du choix même des albums traduits. Les critiques ne devraient-elles pas plutôt s’adresser aux personnes qui choisissent sciemment un certain type de manga et le publie en France ? Dans un monde commercial où le profit l’emporte toujours, il est tout à fait compréhensible que certains ne pensent à mettre sur le marché que des mangas qui se vendent bien, sans considération sur leurs qualités réelles.
Lorsque je regarde les manga choisies par les maisons d’éditions françaises, j’ai la nette impression de n’y voir retenues que celles qui connurent ou connaissent encore un grand succès au Japon. Il est vrai que c’est rentable. Il est tout de même assez simpliste de penser que les mangas ont toujours une mauvaise influence sur les enfants.
De même qu’il y a de bons et de mauvais films, de bons et de mauvais romans, il existe une bonne et une mauvaise manga. Les critères de sélection dépendent de chacun. Il existe ainsi de nombreuses manga de grande qualité encore inconnues du public français, qui manque cruellement d’une vision juste de l’ensemble de la production japonaise. Pour ma part, je trouve que les échanges entre les deux pays ont tout de même été une belle opportunité de susciter des évolutions, celle de la manga au Japon et celle de la bande dessinée en France.
—–
I. : La non publication de la bande dessinée européenne au Japon semble due à une certaine difficulté de traduction et d’adaptation…
J.T. : Une raison en est le manque de compréhension de la bande dessinée de la part des maisons d’éditions japonaises. Il y a également le prix très élevé des ouvrages européens. Comme je l’ai déjà dit, c’est l’aspect commercial qui l’emporte. Au Japon, c’est par un prix bas, et donc accessible, que le grand public acquiert les manga et soutient le monde de l’édition. Comme je ne sais pas lire le français, je ne comprends pas vraiment le sens des histoires développées au sein des albums, mais j’ai l’impression que la bande dessinée européenne se trouve très proche de l’illustration et du livre d’images.
La principale préoccupation de la bd est de montrer des images aux lecteurs, si bien que dans les albums européens, certaines d’entre elles sont traitées de manière très abstraite, et le lecteur japonais a du mal à s’y retrouver, à y projeter ses émotions. Il pense aussi que les histoires manquent de rythme et de vivacité. Il veut pouvoir s’identifier au héros, or lorsqu’on s’attarde et qu’on porte son attention sur le graphisme, ce que l’on fait immanquablement à la lecture d’une bande dessinée européenne, cette démarche d’identification est impossible.
Les auteurs de bandes dessinées japonaises ont toujours essayé de transmettre aux lecteurs des sensations proches de celles du cinéma, ceci par un travail particulier de mise en page et de composition. La narration d’une manga est toujours détaillée, son récit est dense, et il est facile d’y percevoir, d’y comprendre, les émotions de chaque personnage, auxquelles le lecteur nippon attache beaucoup d’importance. Ce lecteur se veut acteur de l’histoire, alors que le Français se positionne comme spectateur. C’est une des raisons pour laquelle la plupart des lecteurs japonais, habitués depuis toujours aux paramètres de la manga, n’arrivent pas à se lancer dans la lecture d’une bd. On peut toutefois ajouter à cela le manque de recherches, d’efforts et de curiosité des éditeurs japonais à l’égard de cette bande dessinée occidentale.
La qualité graphique des dessinateurs de bd est très élevée par rapport à celle des dessinateurs de manga. Cela vient de la riche tradition picturale de la culture française. Il m’apparaît nécessaire pour chacun de faire des efforts afin de comprendre et reconnaître la qualité de l’une et de l’autre, tout en admettant qu’elles continuent toutes deux d’évoluer.
Je crois que le conservatisme est un frein à la progression de l’art. Je suis moi-même fortement influencé par cette bande dessinée européenne, pour laquelle je le répète, le niveau d’expression graphique et celui de l’imagination sont particulièrement élevés, et dont les styles sont très diversifiés et originaux.
I. : La manga, pour sa part, semble connaître un succès mondial et facile…
J.T. : Le succès de la manga ne me semble réellement ni facile ni mondial. Les pays étrangers n’ont connaissance que d’une petite quantité de bandes dessinées japonaises. La plupart d’entre elles restent dans l’Archipel et, commercialement parlant, l’exportation véritable se limite à l’Asie du Sud-Est. Même au Japon, le succès ne s’est pas fait en un jour.
Il y a 30 ou 40 ans, les mangas étaient détestées par les adultes, ces derniers les jugeaient grossières et néfastes sur le plan éducatif. Mais à cette époque, il y avait peu de divertissements, et les enfants se sont précipités sur ces mangas bon marché, réalisées par des dessinateurs souvent talentueux, mais contre une rémunération de misère. Les efforts des auteurs pionniers ont contribué au développement de la manga, et le moyen d’expression a fini par attirer de nouveaux talents et de nouveaux lecteurs…
Le succès de la manga à l’étranger est sans doute dû à sa facilité d’accès, n’importe qui peut y trouver un intérêt. Les histoires sont centrées sur des personnages souvent hauts en couleurs/ le scénario se doit d’être particulièrement divertissant. Quelle que soit la beauté des dessins, si l’histoire est ennuyeuse, le lecteur japonais ne suit pas.
Certes, je conviens que les manga qui ont fait un grand succès au Japon, exportées telles quelles, sont bien reçues à l’étranger et se vendent bien. Cependant la plupart restent considérées comme de la bande dessinée pour enfants.
I. : Les premières images d’Ikaru[7]) me rappellent le dessin de Moebius, et d’autres le style de François Schuiten…
J.T. : Bien sûr, je suis fortement influencé par ces deux auteurs… Non seulement Moebius et Schuiten, mais de nombreux autres dessinateurs de bandes dessinées m’ont poussé à faire de la manga. Les auteurs de bd ont un « sens » du dessin que je ne retrouve pas chez les mangaka, et c’est très stimulant pour moi.
Comme je ne peux pas lire leurs albums, je me concentre sur les dessins, les compositions, les conceptions respectives que ces auteurs ont du monde… Mais ce sont des impressions qui n’émanent que du travail graphique, et non du scénario que j’ai des difficultés à appréhender. Je pense que je ne tarderai pas à entamer l’apprentissage de la langue française, afin de mieux saisir l’originalité de cette bande dessinée que je ne trouve pas dans la manga.
I. : Quelles sont les bases de votre collaboration avec Moebius ?
J.T. : C’est en premier lieu la revue Morning, des éditions Kôdansha, qui m’a contacté parmi d’autres dessinateurs afin de me soumettre les bases du projet et un synopsis. Je les ai tous deux trouvés intéressants, ai eu envie de dessiner une telle histoire et me suis donc proposé pour cette collaboration. Il y avait d’autres candidats, et je ne sais pas pourquoi, j’ai finalement été choisi…
Cela fait environ 18 ans que j’achète des albums de bd dans des librairies spécialisées dans les livres d’importation. J’en possède aujourd’hui un nombre considérable dans ma bibliothèque. La richesse visuelle de ce média est un bon stimulant pour moi. Je ne peux pas tous les citer, mais nombre de dessinateurs occidentaux m’ont influencé… Je fus donc très flatté d’entamer une collaboration avec Moebius, qui est un artiste mondialement connu.
I. : Précédemment, vous aviez déjà accepté de collaborer au travail de Frédéric Boilet…
J.T. : Lorsque j’ai découvert ses albums, j’ai immédiatement apprécié son dessin. J’ai trouvé que Boilet était très fort. Sa touche est particulièrement précise, et c’est un style qui me plaît, pour lequel j’éprouve une grande attirance. Pour tout avouer, j’aurais aimé pouvoir réaliser des manga dans le même style, mais les lecteurs japonais auraient eu du mal à s’y habituer : cela tient à certains contrastes très prononcés entre ombres et lumières, qui font que l’on peut avoir du mal à distinguer les arrière-plans, les personnages, et à suivre les images. Je me suis aperçu que le regard pouvait s’arrêter sur chacune de ses images, au lieu de passer de l’une à l’autre.
J’ai tout de suite pensé à cela, quand on m’a proposé d’effectuer le travail de trame : je me suis dit qu’il devait être possible de rendre ces images plus douées et de leur donner plus d’effet tridimensionnel par l’utilisation d’une trame plus ou moins atténuée. J’ai appris qu’en France, la technique de la trame n’était guère répandue, à l’inverse du Japon, où les maisons d’édition hésitent à publier des ouvrages en couleurs (cela augmenterait le prix de l’album et les ventes seraient moins bonnes). J’espère que l’utilisation des trames grises dans Tokyo est mon jardin contribuera à son développement en France.
Le trait de Frédéric Boilet se rapproche du style européen par son travail sur les contrastes et sur l’utilisation de l’espace, mais je le trouve également très proche du style de l’illustration japonaise. J’ai enfin l’impression que ses oeuvres — leur technique narrative — rappellent les scénarios et la composition des films français. Le rythme narratif de son travail ne correspond absolument pas à un rythme habituel et par définition sécurisant pour le lecteur japonais… mais personnellement, c’est l’un des mes auteurs favoris.
I. : Le rythme de votre récit L’Homme qui marche ne correspond pas non plus à ce qu’attend le lectorat…
J.T. : C’est vrai, et ce doit être l’une des principales raisons de mon statut au Japon. On ne peut pas dire que je sois une star, au sens classique du terme. Un certain nombre de lecteurs est heureusement sensible à mon travail et à ma démarche. Ces derniers me considèrent peut-être comme une star, mais en toute objectivité, mes résultats commerciaux sont là pour démontrer le contraire.
Je suis persuadé cependant que toute la manga ne doit pas ressembler à ce que je fais. Elle a besoin de s’exprimer dans plusieurs genres. Il est très bon pour le média que d’autres personnes désirent tout comme moi postuler à la création de choses différentes… Ceci dit, j’ai le sentiment que l’intérêt que l’on porte à mon travail sur L’Homme qui marche est paradoxalement plus important en France qu’au Japon.
I. : Vous êtes donc prêt à réitirer d’autres expériences de collaboration ?
J.T. : Oui, si l’on me présente des œuvres qui m’attirent et me plaisent. J’aimerais bien connaître d’autres dessinateurs étrangers, afin d’échanger des techniques et des idées.
I. : Doutez-vous parfois de vos capacités ?
J.T. : Par moments, je ressens des limites sur le plan technique. Mais je crois que je peux dépasser ce stade par la pratique, comme je l’ai toujours fait jusqu’à aujourd’hui. Je me creuse toujours la cervelle pour tenter de trouver quel style graphique et quelles mises en scène conviendront le mieux à des oeuvres aux thèmes à chaque fois différents. Mais n’est-ce pas précisément en surmontant une à une ces difficultés que l’on peut progresser et créer de nouvelles formes de bandes dessinées ?
I. : Avez-vous la crainte, un jour, de ne plus aimer ce que vous faites ?
J.T. : Je n’ai jamais détesté mes dessins, mais il est vrai que j’éprouve parfois une certaine crainte. Elle se manifeste quand je ressens les limites de mes propres capacités et de ma technique, au moment de mettre au point le mode de représentation d’une nouvelle histoire.
J’ai le sentiment de devoir toujours élargir mes possibilités d’expression, qu’il s’agisse du dessin, de la mise en scène ou de la composition. Je travaille constamment en affrontant ce dilemme que les dessins de mes ouvrages ne seront jamais parfaits… Quand je me lance dans un nouveau projet, il me faut énormément de concentration pour surmonter la pression que je ressens. Il m’arrive parfois d’échouer. J’ai encore une montagne de choses à apprendre en tant que mangaka.
I. : Comment envisagez-vous votre avenir artistique ?
J.T. : A l’avenir, j’aimerais relever le défi d’oeuvres plus expérimentales, y compris en améliorant mon dessin. Je rêve de mettre à l’épreuve des modes de représentation plus personnels en manga, en dehors de tout contexte commercial. Aujourd’hui encore, le langage de la manga continue d’évoluer et son champ d’action ne cesse de s’étendre. J’espère trouver des moyens d’exprimer fidèlement la partie la plus profonde de l’homme, et notamment la plus philosophique.
Pour l’instant, ma prochaine tentative sera d’exprimer le monde du haiku en manga. Je pense sincèrement que l’art du haiku est l’un des plus fins, des plus insaisissables de la culture japonaise. C’est un univers poétique qui, par son dénuement, révèle la quintessence de chaque mot. J’aimerais dessiner les biographies de poètes de haiku de l’époque Edo…
Je m’intéresse parallèlement beaucoup au film d’animation de marionnettes. Afin de maîtriser ce monde, il faut une grande imagination et une perception très précise de la dimension. Tout doit y être créé manuellement, depuis les personnages jusqu’aux décors, c’est un travail qui exige énormément de temps. Quand il est réussi, un film d’animation de marionnettes nous offre une sensation de toucher que l’on ne retrouve pas dans le dessin animé sur cellulo, ni dans le dessin animé numérique.
Voilà qui donne sûrement l’impression d’aller à l’encontre de la mode actuelle des dessins animés en imagesdesynthèse, mais ce sont précisément tous ces aspects manuels de la création artistiquequi me passionnent.
I. : La mort de Yukio Mishima a-t-elle changéla physionomie socioculturelle du Japon, marqué la fin d’une époque ?
J.T. : Sa mort — mais surtout la façon dont il s’est suicidé — a effectivement créé un bouleversement très important. Toutefois, je ne crois pas que la disparition de Mishima ait changé les bases de la société et de la culture japonaise. Il vaut mieux ne pas concevoir cet événement comme la fin d’une époque, mais plutôt comme le début d’une autre. Il me semble que la forme et le fond de l’oeuvre de Mishima ont trouvé une continuation chez de jeunes auteurs et donné naissance à une nouvelle littérature porteuse d’une conscience et de visions nouvelles du « beau ».
Pour en revenir à l’histoire de la bande dessinée japonaise, il ne s’est écoulé que soixante années depuis que Tezuka a posé les fondements de la story manga[8] . Je lui vois encore de grandes possibilités d’évolution. Au départ, la manga était un divertissement populaire, mais aujourd’hui, avec notamment l’émergence des nouvelles techniques, on assiste à la généralisation d’une manga plus artistique et littéraire, avec une grande diversité de genres. La manga se diversifie chaque jour un peu plus, ainsi que sa clientèle, et je suis persuadé qu’elle évoluera davantage dans le futur.
Aujourd’hui, le développement des techniques numériques a certes une influence croissante sur la manga, mais je ne crois pas que l’on puisse parler d’un bouleversement de fond dans son histoire. Il est dit que l’organe le plus évolué de l’homme est l’oeil. Grâce à la vue, l’homme prend conscience, il perçoit des objets, il juge et finalement peut prendre une décision.
Mais dans le même temps, le toucher de l’homme est aussi aiguisé. Tourner la page d’un livre — et toucher des dessins — est une action concrète et très vivante. Elle est indispensable pour les créateurs et pour les lecteurs. Bien que nous soyons entrés dans l’ère numérique, je pense que les histoires contées au travers de dessins sur le papier survivront, et ce malgré la mutation à laquelle elles seront confrontées.
Propos recueillis par Franck Aveline, publie en février 1998 dans L’indispensable n°0.
Traduction : Kaoru Sikezumi (français-japonais), Naomiki Satô assisté par Bernard Samour (japonais-français).
Textes additifs : Ilan Nguyên et Vincent Zouzoulkovsky
Notes
- « kashihon-ya gekiga » : La location des livres, que désigne le terme « kashihon », fut pendant des siècles le principal mode d’accès des Japonais à la lecture, et l’existence des « kashihon-ya », les loueurs de livres ambulants, n’a pris fin qu’il y a quelques décennies. Le terme générique de « gekiga », apparu dans les années 60, désigne un genre dit « réaliste » de manga, allant du « jidai-geki » (le registre historique) aux histoires de yakuza contemporaines. Ces manga, dénuées de tout caractère comique, visent un public adulte et ouvertement masculin. Avec l’importance croissante que prend ce registre au cours des ans, l’usage du terme a tendu à se généraliser, jusqu’à devenir dans certains cas un synonyme du mot manga.
- « Seinen manga » : manga pour adolescents et jeunes hommes, que l’on peut opposer à la « shôjo manga » bande dessinée pour filles », et aux « Lady’s comtes » bande dessinée pour jeunes femmes ».
- « Mangaka : dessinateur de manga.
- « Mikkyô » : doctrine du Grand Véhicule relevant du bouddhisme ésotérique.
- Botchan no jidai (Au temps de Botchan) : série en cinq volumes parus entre 1987 et 1997, dessinée par Taniguchi sur un scénario de Natsuo Sekikawa. Botchan est l’une des premières oeuvres de l’écrivain japonais Sôseki Natsume, personnage central de cette évocation à caractère biographique de quelques-uns des plus grands auteurs de la fin de l’ère Meiji au Japon.
- Chichi no koyomi (le Calendrier du père) : album à caractère (semi-)autobiographique en douze chapitres prépubliés d’avril à octobre 1994 dans la revue Big Comic des éditions Shôgakukan.
- Ikaru (Icare) : en cours de publication dans l’hebdomadaire Morning chez Kôdansha. (scénario de Mœbius
- « Story manga » : bande dessinée narrative, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Le mot manga, comme de nombreux mots japonais, a connu changements de sens et acceptions successives au cours du temps. C’est ainsi qu’au début de ce siècle, il désigne les illustrations à caractère satyrique apparues dans la presse japonaise qui vient se moderniser sur le modèle journalistique occidental. Le terme monogatari manga désigne le passage de la manga de la « caricature » à la « bande dessinée ».
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée

 Le Gourmet Solitaire
Le Gourmet Solitaire


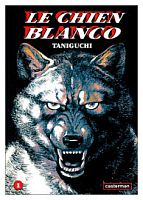




















An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster