Musée(s)
Peut-on exposer la bande dessinée ? Comment donner à voir ce qui se lit ?
Ayant ouvert ses portes le 25 Novembre 2005, le Musée International du Manga à Kyōto a choisi une solution intéressante à ce problème : puisqu’en premier lieu, le manga se lit, autant proposer à ses visiteurs une vaste sélection de livres en accès libre. On y trouvera donc quelques salles réservées aux expositions temporaires, et en lieu et place des traditionnelles collections permanentes, d’imposants «murs de manga» occupant les longs couloirs de cette ancienne école primaire. Et de croiser des lecteurs absorbés un peu partout, en haut des escaliers, devant les ascenseurs, voire allongés sur la pelouse quand le temps se montre clément.[1]
On est bien loin des habituelles expositions de planches originales — mise en avant (sacralisée) d’un fragment de récit, dans des dispositifs qui mettent l’accent sur le dessin et sa création, et qui finalement viennent en complète contradiction avec ce qui fait la spécificité et l’intérêt de la bande dessinée en tant que mode d’expression narrative. A Kyōto, on touche, on feuillette, on lit, à moins que l’on ne préfère assister à l’une des séances quotidiennes de kamishibai[2] — bref, on découvre.
Cependant, si l’approche est intéressante, la réalisation se montre bien en-dessous des attentes.
Tout d’abord, il est regrettable que la partie véritablement muséale soit limitée à la portion congrue — un simple couloir au sous-sol, qui laisse entrevoir de l’autre côté d’une grande vitre les collections de magazines destinées à la recherche. Là, quelques présentoirs retracent dans les (très) grandes lignes l’histoire du manga avec quelques pièces exposées : e-makimono, manga d’Hokusai, les premiers périodiques (Tokyo Puck et Japan Punch, dont quelques exemplaires sont consultables en version numérisée), et puis l’ère des mangashi avec la montée du succès populaire.
Même regret quant aux espaces réservés aux expositions temporaires. Certes, l’exposition principale consacrée à Sugiura Shigeru[3] bénéficie de deux grandes salles avec une mise en espace ludique, présentant des originaux plus un certain nombre d’éditions d’époque. Pour les autres, par contre, salle unique et peu de pièces exposées — que ce soit pour l’introduction à la bande dessinée francophone, assez correcte (malgré une place démesurée accordée à Jean-David Morvan et ses tentatives d’hybridations) ou pour l’exposition consacrée au calligraphe responsable d’un certain nombre de logos d’Afternoon.[4]
Il y a donc là quelque chose d’étrangement amateur, ou sous-développé, dont je ne sais s’il s’agit d’un travers inhérent aux musées japonais dans leur ensemble, ou d’un cas particulier.
A trop vouloir devenir un lieu de lecture, le musée de Kyōto finit également par oublier sa fonction première, et se montre plus préoccupé par des problématiques de rangement que celles d’exposition. Il est ainsi très dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’efforts pour «mettre en scène» les murs de manga et proposer autre chose qu’une banale organisation par genre et par auteur. Pourtant, la longueur des séries japonaises et leur publication périodique aurait pu donner lieu à la mise en place d’une «chronologie concrète», permettant de retracer au gré des titres emblématiques tel ou tel âge d’or — quitte à devoir reléguer les œuvres de moins d’importance dans des salles de lecture annexes.
Mais l’on touche ici à l’une des lacunes les plus frappantes de ce musée — à savoir l’absence quasi-totale du gekiga (et plus généralement, du manga alternatif) dans ses rayonnages : hors Shirato Sanpei et Tsuge Yoshiharu, on cherchera en vain des ouvrages issus des auteurs phares de Garo.[5] On en vient même à se retrouver face à un paradoxe étrange : alors que l’exposition du moment (dont l’affiche est placardée un peu partout) met à l’honneur le travail de Sugiura Shigeru, on cherchera en vain ses œuvres dans les collections du musée — les seuls ouvrages disponibles étant les rééditions proposées pour l’occasion, consultables sur une table dans la seconde salle d’exposition ou en vente à la boutique à l’entrée.
Et malheureusement, du fait de l’organisation de la structure (mi-universitaire, mi-privée), il n’y a pas de projet actif de complétion de cette collection. Le site web fait bien appel aux dons, mais on s’inscrit alors plus dans l’approche d’une bibliothèque que celle d’un musée cherchant à compléter activement son fonds afin de se doter d’ouvrages jugés importants.[6]
Ainsi, lieu agréable et convivial, le Musée International du Manga à Kyōto laisse pourtant comme un goût d’inachevé — et laisse résolument sur sa faim. Le 20 Juin prochain (dans le cadre de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image), le tout nouveau Musée de la Bande Dessinée ouvrira ses portes à Angoulême avec de belles ambitions.[7]
Les parallèles avec le musée de Kyōto sont d’ailleurs nombreux : tous deux liés à une structure officielle de recherche sur la bande dessinée, tous deux installés dans des bâtiments réhabilités, tous deux situés dans une ville de province facilement accessible en train de la capitale…
Restent à découvrir les choix de ce nouveau musée d’Angoulême pour aborder l’épineuse question : comment exposer la bande dessinée ?
Notes
- Certes, un observateur un peu cynique pourrait arguer que le succès du lieu tient peut-être plus au coût du l’entrée (Y500 pour un adulte, valable toute la journée), ce qui en fait de très loin le moins cher des manga-kissa.
- Sorte de petit théâtre ambulant traditionnel, utilisant une succession de scènes illustrées pour constituer une sorte de diaporama pour accompagner la narration du conteur. Initié par les moines bouddhistes au XIIème siècle, cette forme de narration connut un regain d’intérêt à partir des années 20 et jusque dans les années 50.
- Intitulée «Bōken to Kisō no Manga-ka — Sugiura Shigeru 101-nen Matsuri» («Le manga-ka de l’aventure et de l’étrange — 101ème anniversaire de Sugiura Shigeru»), accessible pour Y500 en plus de l’entrée normale.
- «Manga Title Logo and the Aesthetics of Syo — The Works of Juichi Yoshikawa».
- On ne trouvera ainsi qu’un seul volume pour les auteurs suivants, dans les collections fermées au public : Tatsumi Yoshihiro, Tsuge Tadao, Maruo Suehiro, Takita Yuu. Pas trace par contre d’Abe Shin’ichi, Kaneko Atsushi, Mizuno Junko, Matsumoto Taiyō ou encore Matsumoto Jirō.
- Et ce, d’autant plus que la cellule de recherche qui lui est rattachée (et donc dédiée au manga) dispose d’un fonds riche de plus de 200,000 volumes. Ce n’est donc pas de ce côté-là qu’il faudra attendre une motivation à enrichir l’existant.
- Sur la page officielle annonçant l’événement, on peut lire :
«Le visiteur y découvrira tout ce qui fait la richesse et la diversité de la bande dessinée à travers la présentation de planches originales, de documents imprimés et d’objets dérivés, mais également à travers la lecture d’albums qui seront proposés dans des points lecture. Tout au long du parcours, le visiteur sera ainsi invité à s’arrêter pour se plonger dans la lecture de bandes dessinées, que ce soit pour quelques minutes ou pour des heures entières.»
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée










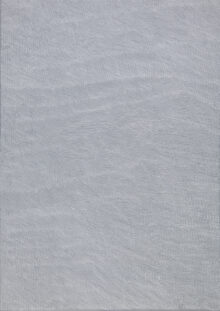











An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster