[SoBD2014] Revue de littérature
- (1) [SoBD2014] Revue de littérature (1/3)
- - (2) [SoBD2014] Revue de littérature (2/3)
- - (3) [SoBD2014] Revue de littérature (3/3)
Renaud Chavanne : Bienvenue dans cette troisième revue de littérature du SoBD, une rencontre annuelle durant laquelle nous commentons un certain nombre d’ouvrages parus depuis l’édition précédente du salon. Hier, pour la première fois, nous avons élu un livre comme étant le livre remarquable de l’année 2014, en lui décernant le prix Papiers Nickelés SoBD après une série de débats auxquels ont participé des gens du SOBD, l’académie de stripologie, et le comité de la revue Papiers Nickelés. Une soixantaine de titres avaient été identifiés cette année parus sur la bande dessinée et le dessin au sens large, il en a été fait une première sélection, puis après des débats qui ont été assez longs, on a choisi le livre de Thierry Groensteen, Monsieur Töpffer invente la bande dessinée. C’est donc un livre marquant, je pense que celui-ci l’est particulièrement. On peut dire de certains livres, à leur sortie, qu’il s’agit du ou des livres importants des deux-trois années. De mon point de vue, c’est le cas de celui-ci.
Antoine Sausverd : C’est un livre qui a connu en fait une première version il y a exactement vingt ans, en 1994. Il s’appelait à l’époque Töpffer, l’invention de la bande dessinée. Mais cette version n’est pas une simple réédition, ni une mise à jour. Elle a été complètement été remaniée, et le texte de Groensteen a presque doublé de taille. A l’époque, il l’avait écrit avec Benoît Peeters. Dans cette version, Groensteen a conservé la partie consacrée aux albums dessinés de Töppfer, en il a reprit le texte et l’a amélioré. Pourquoi ? Parce qu’en vingt ans, énormément de choses se sont passées, tant au niveau de la recherche en général sur les littératures dessinées du XIXe siècle qu’en ce qui concerne Töpffer. Il y a une vingtaine d’années, on ne connaissait pas vraiment son rôle dans les histoires en image de l’époque, alors qu’aujourd’hui le dessinateur suisse est devenu une référence incontournable, reconnue de façon internationale. Il faut également signaler que Thierry Smolderen a publié Naissances de la bande dessinée en 2009, un travail tout aussi important au niveau théorique et qui remettait partiellement en cause la vision de Thierry Groensteen. On peut penser que cette nouvelle version du livre de Groensteen a également été impulsée par ce débat. Le changement du titre est important, puisqu’en passant de « l’invention de la bande dessinée » à « Töpffer invente la bande dessinée », on passe à l’affirmative, comme si Groensteen voulait en cela enfoncer le clou.
Dans ce livre, il présente une partie de l’œuvre de Töpffer, œuvre qui est riche, car le dessinateur a fait beaucoup de choses dans sa vie. Groensteen présente les sept albums de bande dessinée créés par Töpffer durant les années 1830. Il les décrit, mais il parle également de ce qui a pu les précéder. Groensteen considère que la narration en images existait depuis longtemps, qu’on peut la faire remonter à la Tapisserie de Bayeux (certains l’ont même fait remonter jusqu’à Lascaux). Ce qui est intéressant dans ce livre, c’est qu’il décrit un « moment Töpffer », ce qui signifie que si la narration en images a existé au XVIIIe siècle et s’est développée bien avant Töpffer, celui-ci, d’une façon quelque peu originale, arrive à créer un médium qui n’existait pas avant, et de surcroit il le théorise et lui donne un nom. C’est une sorte de cristallisation qui va par la suite engendrer des héritiers ; d’autres artistes qui vont s’en emparer de cette forme, la modifier, la transformer, et elle va devenir ce qu’on appelle aujourd’hui la bande dessinée.
Töpffer, l’invention de la bande dessinée est un livre riche, théorique, historique — il a une approche assez complète des albums réalisés par le dessinateur genevois. C’est un ouvrage vraiment intéressant, même pour ceux qui ne connaissent pas Töpffer. La lecture de ce livre-clé permet de se plonger dans l’histoire des origines de la bande dessinée, chose qui n’est pas encore très connue, mais également dans la question de sa définition.
Renaud Chavanne : Selon moi, l’un des intérêts de ce livre est effectivement la prise en compte par Groensteen des arguments et contre-arguments apportés par Smolderen dans son ouvrage précédent, livre qui est aussi, à mon avis, l’un des ouvrages clés des dix dernières années. L’une des objections de Smolderen aux travaux antérieurs de Peeters et de Groensteen concernant Töpffer consistait à avancer que le dessinateur suisse dénonce le médium qu’il est en train de créer. Töpffer, estime Smolderen, remet en cause une certaine vision industrielle frénétique avec des histoires où l’on est tout le temps en train de courir, de s’envoler, d’éclater. Autrement dit, selon Smolderen, Töpffer a une approche ironique de son propre médium. C’est un point extrêmement intéressant abordé par Smolderen : ce faisant, Töpffer détruirait ce qu’il est en train d’inventer. Ce point de vue de Smolderen était évidemment problématique, d’abord par l’affirmation qu’il posait, ensuite par la démonstration extrêmement complexe qui était mise en œuvre. L’un des intérêts, à mes yeux, du livre de Groensteen, c’est de se demander très simplement si quelqu’un peut produire pas moins de sept livres à vocation artistique uniquement pour dénoncer quelque chose. Serait-il véritablement pertinent, lorsque l’on cherche à dénoncer quelque chose, d’en parler tant ?
Harry Morgan : Je regrette que des historiens aussi éminents que les deux Thierry (Groensteen et Smolderen) se soient égarés sur un débat portant sur les origines, et donc introduisant, qu’ils le veuillent ou non, un biais téléologique, un évolutionnisme avec une finalité, un but qui serait posé, et qui serait la bande dessinée actuelle. Cela incline forcément Thierry Groensteen à lire à rebours Töpffer en y voyant l’invention de la bande dessinée moderne parce qu’il y retrouve un certain type de narration, une certaine définition du personnage, un certain type d’humour. Inversement, Thierry Smolderen souligne que cela est repris de façon ironique et que par conséquent cela n’invente rien, puisque cela n’est pas fondé sur quelque chose que l’on refuserait. Il me semblerait beaucoup plus pertinent d’examiner les œuvres dans leurs époques, et donc dans leur tradition. On se rendrait compte que, par exemple, Töpffer est un homme du XVIIIe siècle, raison pour laquelle il se réfère lui-même à William Hogarth. Il n’y a pratiquement rien de commun entre les modes narratifs de Hogarth et ceux de Töpffer, mais Töpffer nous indique ici l’origine. Inversement, la postérité de Töpffer, il faut aller la chercher (et là, Thierry Smolderen serait d’accord) en Angleterre chez les Victoriens, qui vont relancer une fois de plus un type d’humour qui passera entretemps en littérature écrite par Charles Dickens — je pense aux Pickwick Papers. Bref, ne nous demandons pas éternellement quels sont les trois critères qui correspondraient à la bande dessinée moderne. Il me semble du reste que Thierry Groensteen affaiblit quelque peu son argument quand il reconnaît qu’à la même époque que Töpffer d’autres pratiquaient aussi la bande dessinée. Et pour cause ! tout le monde invente la bande dessinée tout le temps. Ces différentes bandes dessinées qu’on invente, regardons-les, étudions-les dans leur jus.
Florian Rubis : Je retiens quelques points intéressants du débat, notamment lorsque Thierry Groensteen parle pour Töpffer plutôt d’un précurseur décisif. Ce que j’aime bien également dans ce que nous apporte son contradicteur, c’est le pluriel qu’il emploie dans le titre de son ouvrage. On en discutait hier soir avec certains des invités britanniques de ce SoBD 2014. En outre, Groensteen a d’ailleurs eu une remarque judicieuse en disant qu’on ne risquait pas d’en sortir, puisque chacun avait sa propre conception de la bande dessinée, et peut répondre différemment à chaque fois. Comme le rappelait Harry Morgan, Hogarth est une balise pour Töpffer, mais on peut en identifier plusieurs autres, et surtout des Britanniques justement : [James] Gillray, [George] Cruikshank, etc. On peut aussi se souvernir du personnage Ally Sloper, créé en 1867 en Angleterre, où l’on a déjà le phylactère, et qui présente une forme déjà aboutie de la bande dessinée à destination d’un public de masse, avant même 1895-1896 et ce qui se passa alors aux États-Unis. Ce qui m’intéresse dans tout ça, ce sont les paradoxes que nous offre la bande dessinée, et qui nous nourrissent.
Renaud Chavanne : Nous avons donné à ce livre le prix Papiers Nickelés SoBD parce que c’est en quelque sorte la concrétisation d’une œuvre. Thierry Groensteen est quelqu’un qui travaille depuis très longtemps sur la bande dessinée, qui a écrit énormément de choses. Généralement, ces textes sont d’une lecture agréable et aisée, ce qui fait qu’il est difficile de ne pas vous recommander l’un de ses livres. Mais il faut bien dire que Groensteen pratique une recherche qui est extrêmement éclectique et éclatée. Or, dans l’ensemble de son travail, il y a deux livres qui en sont un petit peu les fils directeurs. Le premier, c’est le Système de la bande dessinée, qui a été un jalon important dans la théorie de la bande dessinée (il y a eu un deuxième tome, à mon avis d’une portée moins importante). Le deuxième grand travail de Groensteen, ce sont ses études sur Töpffer. En récompensant par notre prix ce livre, nous récompensons aussi l’un des deux grandes directions d’études de Groensteen.
Sylvain Insergueix : J’ai commencé à m’intéresser à la bande dessinée à la toute fin des années 1960, à une époque où ce débat n’aurait même pas pu être envisagé. J’ai rencontré Thierry en 1971, si mes souvenirs sont bons, et d’entrée de jeu, il avait une vision d’analyse de la bande dessinée, ce qui à cette époque était excessivement rare. L’histoire retracera toutes ces années, mais Thierry a toujours cherché insisté sur l’étude de la bande dessinée. Nous pensions qu’avec la bande dessinée on pourrait faire des choses qui aujourd’hui sont publiées : du reportage, du journalisme, du social, etc. A l’époque, il n’y avait quasiment rien de tout cela. Par bonheur, nous avions devant Forest et Druillet. Mais c’était tout. La bande dessinée était considérée comme une invention américaine. C’était ça, la vision de la fin des années 1960. Je rends grâce à tous ces gens, chercheurs, journalistes, qui ont effectivement travaillé sur le sujet.
Manuel HirTZ : Pour ma part, c’est un livre que j’ai lu avec beaucoup de plaisir, alors même que je n’aime pas le travail de monsieur Töpffer, que je trouve platement dessiné et peu drôle.
Nicolas Rouvière (dans la salle) : J’ai le souvenir du livre de 1994, ainsi que celui de Thierry Smolderen sur les Naissances de la bande dessinée. Ce que j’avais apprécié en 1994 dans l’argumentaire de Thierry Groensteen, c’est la légitimation par Töpffer du style gauche et rapide, en disant qu’il y avait là un potentiel d’expressivité extraordinaire, et que c’était un dessin d’idée. Il n’y a pas de recherche de mimesis, ou d’imitation du réel chez Töpffer. Dans ce processus, il me semble qu’il y a un moment très important (c’est une chose si évidente qu’elle n’est pas assez mise en valeur) : c’est le moment révolutionnaire. Au moment révolutionnaire et contre-révolutionnaire, il y a une explosion de la caricature, et de la caricature rapide, la caricature à dix sous, celle qui est accessible aux ouvriers, accessible au petit peuple, qui est produite en grande quantité et qui se vend dans Paris. Elle n’est pas séquentielle, pourtant le style de Töpffer est à mon sens déjà en germe dans la gaucherie que l’on trouve dans ces caricatures vendues sous le manteau. Cependant, ces caricatures sont aussi un peu de l’ordre du feuilleton, parce qu’elles sont produites jour après jours, sans arrêt. Il y a des échos, on se répond, les caricaturistes dialoguent. L’idée du mouvement, de l’accélération et du populaire, il faut essayer de la repenser aussi dans cette naissance-là. En 1989, au moment du Bicentenaire, il y a eu la publication, par le CNL je crois, de deux gros tomes sur la caricature révolutionnaire : on y retrouve des reproductions vraiment très Töpfferiennes.
Renaud Chavanne : C’était l’intérêt à mon sens du travail de Thierry Smolderen, après celui de Thierry Groensteen, de justement replacer tout cela dans un contexte, aux côtés d’autres artistes, et de montrer effectivement comment le travail de Töpffer s’inscrivait parmi d’autres travaux qui étaient globalement de type caricatural.
Mais passons à présent à un livre consacré à Rosy et intitulé Rosy, c’est la vie.
Sylvain Insergueix : Bien qu’il date de 2014, ce livre a été publié dans le cadre des 75 ans du magazine Spirou, anniversaire a été célébré en 2013. En effet, Rosy, décédé peu avant la publication de ce livre-témoignage, aura été un auteur important de la vie du Journal de Spirou. Un auteur, mais aussi un acteur très important, qui est resté malgré lui discret et peu connu. Il y a nombre de raisons à cette discrétion, et le mérite de ce livre (ce n’est pas le seul ) est de nous le faire découvrir.
En premier lieu, Maurice Rosy est un homme modeste, talentueux mais s’effaçant souvent au service des autres. C’est un ami de jeunesse d’Yvan Delporte, le rédacteur en chef mythique du Journal de Spirou. C’est Rosy qui a transformé le magazine de bande dessinée, faisant d’une publication pour la jeunesse un journal moderne. Rosy a été embauché par monsieur Dupuis comme « donneur d’idées » — il raconte dans ce livre que c’était ce qui était inscrit sur sa fiche de paye. D’emblée, Rosy travaille dans l’ombre ; son nom sera cependant cité sur de nombreux albums d’auteurs célèbres : il a fait des scénarios de Spirou pendant la grande époque de Franquin, il a travaillé avec Deliège, avec Degotte, avec Peyo, avec Roba, et bien d’autres. Il aide les auteurs en mal d’idées. L’existence même de ce livre, on le tient de ses auteurs, aura été de longs mois suspendue à l’accord de Rosy. Il refusait de le donner, arguant que son sujet, c’est-à-dire lui-même, n’en valait pas la peine. J’y reviendrai un peu plus tard.
En deuxième lieu, vers la fin des années 1960, Rosy, âgé alors de 41 ans, abandonne complètement la bande dessinée et ses nombreux scénarios, pour repartir à zéro. Il déménage de Bruxelles et s’installe à Paris pour travailler dans la publicité puis dans la presse jeunesse où il rencontrera d’ailleurs de très beaux succès. Il disparaît donc du milieu de la bande dessinée, au moment-même où l’intérêt pour celle-ci commence à émerger. Conséquence : Rosy sera donc oublié dans les années soixante-dix, y compris par des auteurs qui lui doivent beaucoup et dont la célébrité augmente. Je me souviens très bien avoir interviewé Franquin, pendant toute une journée, sans qu’il ne parle une seule fois de Rosy. Et pourtant, Rosy est cité comme le scénariste d’albums assez mythiques pour certains [comme Le Dictateur et le Champignon ou Les Pirates du silence]. Ainsi, le fandom naissant de la bande dessinée du début des années soixante-dix ne citera pas Rosy — je crois qu’il n’est mentionné que très tard, dans des publications de la fin des années 1980, début 1990. Notamment pour ses scénarios de Bobo.
Ces points sont importants pour comprendre la forme et le fond du livre. Quant à la forme, c’est un livre est resserré, petit, plus proche du pavé que du codex — ce genre de format est assez rare pour les livres monographiques. À la lecture, le propos est fluide et laisse beaucoup de place à des illustrations. Il y a beaucoup de documents photographiques, de reproductions du Journal de Spirou et d’autres publications Dupuis, y compris des propres dessins de Rosy. On découvre au passage que c’est un très bon dessinateur.
Venons-en au fond. Les auteurs ont cherché une idée pour convaincre Rosy d’accepter ce livre-témoignage. Finalement, un accord a été trouvé : le livre propose donc une longue interview, au ton décontracté, au cours de laquelle Rosy aborde toute sa vie. Sa jeunesse, sa famille (propriétaire d’une fabrique artisanale de clous), ses relations avec son père ; la rencontre et sa complicité avec Yvan Delporte, sa découverte du Jazz (il a lui-même vécu une petite vie de musicien), son entrée chez Dupuis, sa vie professionnelle, ses projets. Puis son départ à Paris, toute la fin du livre étant constituée d’une longue iconographie de ses travaux publicitaires et pour la jeunesse, où l’on retrouvera des images très connues. Surtout, Rosy enrichit les pages — et ceci dès la couverture du livre — de dizaines de commentaires sous forme de dessins, ou parfois de petits textes manuscrits, au trait lâché mais toujours très précis, très vivant et d’une justesse étonnante. Son propos est décalé et très humoristique, ce qui permet de bien mesurer qui était réellement cet individu : lorsqu’il fait ces dessins, Rosy a 80 ans !
Renaud Chavanne : On lui a demandé d’illustrer l’interview. Il a commencé en encrant ses dessins, avant de faire le choix du crayon à papier. Et sans reprise, directement.
Sylvain Insergueix : Cela se voit très bien avec le dessin de couverture, qui est tout-à-fait significatif.
Renaud Chavanne : C’est un dessin vraiment étonnant. On n’imagine pas un monsieur de 80 ans derrière ce dessin-là. On a l’impression d’avoir quelque chose de très vivant, c’est très surprenant.
Sylvain Insergueix : Au travers des anecdotes et des commentaires, on approche l’auteur et toute sa production, qui est immense, mais toujours présentée avec une modestie incroyable. Il faut souligner également la maquette de Philippe Ghielmetti, qui a entièrement composé tous les livres parus dans le cadre des 75 ans de Spirou. Philippe Ghielmetti a choisi une police de caractère très particulière : au premier abord, elle paraît c’est assez peu appropriée pour ce genre d’ouvrage. C’est très déconcertant lorsque l’on commence la lecture. Mais en définitive, avec cette police, Philippe essaye de nous faire entrer dans l’esprit de Rosy. C’est une police qui ne paye pas de mine, qui est un peu anodine, désagréable, presque, mais qui est très inventive. C’est finalement assez efficace.
Renaud Chavanne : Il est indiqué à la fin du livre que le lettrage a été dessiné par Philippe Glogowski d’après les propres alphabets de Maurice Rosy, puis vectorisé. Je suis assez réservé sur le résultat en ce qui me concerne. Sur la forme du livre, il y a une sorte de chose un peu étrange : à la fois on attend pour ce livre quelque chose de souple, de léger, de manipulable facilement, parce que le propos de Rosy est un propos léger, dynamique. C’est un vieux monsieur de 80 ans qui est très jeune, en fait. Cependant, transparaît dans la forme de ce livre la volonté de faire quelque chose de définitif, de lourd. On est dans le registre patrimonial, qui semble imposer, un dos rond, une couverture qui soit bien reliée… c’est peut-être un peu dommage. La fluidité qu’évoquait Sylvain vient du peu de lignes par page : à peine une vingtaine de lignes par page. En conséquence, on passe son temps à tourner les pages. Mais en réalité, ce livre aurait pu tenir en moitié moins de feuilles s’il avait été composé de façon plus dense, plus efficace, et à mon avis on aurait quelque chose de…
Sylvain Insergueix : Mais je pense que Rosy l’a voulu comme ça. Il faudrait demander à l’éditeur.
Renaud Chavanne : C’est un livre dont la forme étonne, en tous cas.
Sylvain Insergueix : Je dirais pour conclure qu’on découvre à travers ce livre un homme oublié du public et de la profession. C’est un bel hommage.
Renaud Chavanne : Je me suis demandé si Rosy, ce n’était pas un peu le Van Melkebeke de la maison Dupuis. Le personnage souterrain qui est derrière les auteurs, qui accepte de s’effacer derrière eux, qui ne cherche pas à tirer la couverture à lui, mais dont la présence traverse toute l’histoire du journal, et permet probablement de comprendre certaines orientations. Sylvain évoquait son attrait pour le Jazz. Il y a des dessins d’époque qui sont étonnamment modernes, et qui détonnent dans l’environnement éditorial de la maison Dupuis — laquelle semble parfois relativement figée, véhiculant une forme que l’on a déterminée comme étant celle qui doit convenir à un dessin pour enfant.
Sylvain Insergueix : À ceci près que Rosy est cité. Son nom apparaît sur les albums de Franquin, il est cité comme scénariste ; il est cité évidemment pour Bobo, il est cité pour tout ce qu’il a fait pour Deliège, il est même cité par Roba pour deux-trois gags de Boule et Bill : Roba inscrit son nom en bas.
Renaud Chavanne : Les gens de chez Spirou étaient beaucoup plus ouverts sur ce point qu’Hergé, qui voulait garder la paternité entière de ce qui était produit. Mais il n’en reste pas moins que si l’on parle avec quelqu’un qui a lu de nombreux livres de Franquin ou de Peyo, et qu’on évoque Rosy devant lui, il est fort probable que ce nom lui rappellera quelque chose, mais sans plus.
Xavier Guilbert (dans la salle) : Ce qui me marque, c’est la question des auteurs de ce livre. Vous ne les avez pas cités, ils ne figurent pas sur la couverture de l’ouvrage, et c’est je crois la marque de tout ce qui est sorti pour les 75 ans de Spirou. C’est une conversation avec Rosy, mais on ne sait pas qui parle avec lui…
Christian Rosset (dans la salle) : C’est parce que l’auteur et l’éditeur sont une seule et même personne.
Sylvain Insergueix : L’esprit des éditions Dupuis se trouve toujours là. Un des trois auteurs est éditeur ; salarié de la maison Dupuis, certes, mais bien éditeur. Le second est effectivement aussi l’éditeur de ces collections, José-Louis Bocquet. Et la troisième intervenante est la jeune femme qui coordonne tout cela. Du coup, en effet, il n’y a pas réellement d’auteur. D’autant plus que le texte est une interview. Une interview qui a été conduite par ces trois personnes.
Renaud Chavanne : Sylvain aime beaucoup cette situation, parce que tout ça cela fait des gens très modestes qui ne disent jamais ce qu’ils ont fait [rires]. Mais effectivement, la remarque de Xavier est extrêmement intéressante : pour tous ces livres, il n’est pas dit clairement qui les a faits. Il y a un projet derrière ces ouvrages, et le fait de ne pas mettre en avant le nom de l’auteur, ne contribue pas à rendre le projet clair : on ne sait pas qui en est à l’origine. Il y a bien un ours, mais il faut aller le chercher à l’intérieur.
Christian Rosset : Deux remarques. La première, c’est l’idée de mettre en gros sur la couverture le nom de l’auteur en tant que sujet. Sylvain, qui a travaillé à Futuropolis, verra ce que je veux dire. En ce qui concerne le titre, Rosy, c’est la vie, c’est quand même une référence à Marcel Duchamp : « Rrose Sélavy » était l’un de ses pseudonymes. J’ai demandé à José-Louis Bocquet de qui était ce titre : c’est de Rosy. L’un des avantages de l’entretien et de la parole, c’est qu’il s’y produit des choses qui ne sont pas prévues.
Renaud Chavanne : Dans le livre, il est dit qu’ils avaient choisi un autre titre, mais qu’ils n’arrivaient pas à s’en satisfaire. Mais il n’est pas précisé que le choix du titre ait été fait par Rosy.
Christian Rosset : Mais il l’a accepté.
Renaud Chavanne : Il l’a plus qu’accepté…
Sylvain Insergueix : Ceci dit, quand on voit toute l’iconographie regroupée en fin d’ouvrage, les travaux publicitaires, les travaux pour la jeunesse, on est bien forcé de constater que Rosy était quelqu’un qui avait énormément d’idées, beaucoup de références, une grande culture, et qui, effectivement, ne faisait jamais les choses vraiment au hasard. C’était quelqu’un de réfléchi, et on peut penser que ce livre, dont José-Louis dit qu’il a été difficile à réaliser parce que Rosy n’en voulait pas, a été fait aussi avec beaucoup de concessions et d’accords de Rosy. En fait, c’est une interview relue, c’est un livre relu, refabriqué par Rosy, créateur, publiciste, qui met un petit peu en scène ici une partie de sa vie.
- (1) [SoBD2014] Revue de littérature (1/3)
- - (2) [SoBD2014] Revue de littérature (2/3)
- - (3) [SoBD2014] Revue de littérature (3/3)
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée


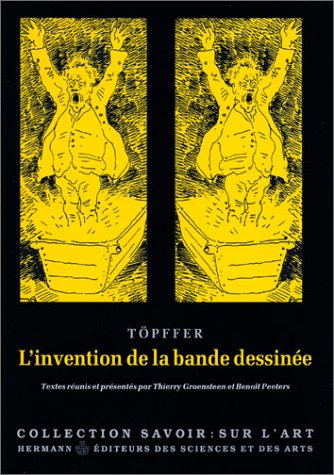




















An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster