Thomas Gosselin
Dans ses livres, Thomas Gosselin aime bien les systèmes que l’on examine et que l’on questionne, que l’on triture et que l’on tord. Au petit matin à Angoulême, pourtant, c’était surtout la nervosité qui prédominait. Le café aidant, la conversation a fini par se délier autour de son dernier ouvrage, Au recommencement, qui vient d’être publié chez Atrabile. Une bonne occasion pour aller explorer un peu plus son univers.
Xavier Guilbert : Il y a une phrase dans L’humanité moins un qui m’a marqué, et qui à mon sens correspond bien à tes deux derniers livres. Un de tes personnages dit : «tout repose sur la méthode, dont je vais maintenant te faire la démonstration». Il y a chez toi une approche très construite, presque didactique, beaucoup de moments où les personnages vont expliquer quelque chose. C’est ta formation en philo qui ressort ?
Thomas Gosselin : En fait, ma formation en philo, elle est pas très — enfin, j’ai fait un an et demi, donc elle n’est pas très importante. C’est surtout au lycée que j’aimais bien ça. En fait, ce sont des gens qui expliquent des trucs, effectivement, mais c’est parce que j’aime bien. A chaque fois, ce sont des théories que j’ai envie de… et le meilleur moyen que j’ai trouvé pour l’instant, c’est qu’il fallait des gens qui expliquent. Mais normalement, ça va changer, dans mes prochains livres…
XG : L’humanité moins un m’a fait penser à Pérec, avec La disparition, où tu as des personnages qui au fur et à mesure, se rendent comptent qu’ils font partie d’un système. Et il y un petit peu cette prise de conscience que quelque chose s’organise autour d’eux, et ils se retrouvent dans des situations avec un système qui est mis en place, et avec lequel ils doivent composer. Des systèmes clos, avec une règle, et il faut s’y plier et essayer de s’en tirer.
TG : C’est surtout par rapport à mes lectures — enfin, Borges — de littérature latino-américaine, comme ça. Ce sont des trucs que j’aime bien, le genre d’histoire que j’aime bien entendre, et donc j’aime bien les raconter aussi.
XG : Oui, en littérature, il y a aussi Paul Auster que l’on pourrait voir comme référence pour L’humanité moins un, avec ce personnage qui invente un nouveau langage.
TG : Oui oui, je sais. En fait, il y a plein de mecs qui ont inventé des langues, en même temps qu’ils inventaient l’espéranto, il y a énormément de types qui ont inventé des langues censées réconcilier les gens. Jean-Pierre Brisset, un fou qui a imaginé des grammaires étranges et des étymologies absurdes — il y a plein de fous, ou de philanthropes. C’est un truc que je trouvais marrant.
XG : Dans ces deux livres, je retrouve très fortement l’interrogation sur la manière dont on définit, dont on appréhende le monde. L’idée dans L’humanité moins un que le langage définit le monde, d’une certaine manière, et dans Au recommencement, il y a le personnage d’Abel qui dit «mon corps c’est le monde» en manière d’appropriation. Et ensuite, toute la ville qui résonne au personnage de Machine.
TG : En fait, ce que j’aime bien dans certains textes de philosophie, c’est qu’on a l’impression qu’ils essayent de trouver, de détruire le monde. Ils cernent un système super clos, et ils essayent de trouver les paradoxes, les contradictions qu’il y aurait dans le système. Et si elles éclatent, tout le système s’écroule. Et je trouve ça marrant d’appliquer ça au monde entier, de trouver les endroits qui feraient exploser le monde.
XG : Il y a aussi l’élément de la transformation — de la transformation et de l’identité que je trouve très présents. Je l’ai trouvé très marqué dans le jeu de transition. Les transitions sur le texte avec les séquences qui s’enchaînent dans L’humanité moins un, avec des identités de textes qui viennent renforcer la thématique que si l’on dit la même chose, on devient les mêmes. Et des jeux de transition plus visuels dans Au recommencement,.
TG : Oui, en fait ce sont des trucs qui me font peur, les changements d’identité. Des trucs comme ça. C’est pour ça que j’en parle, je ne sais pas trop pourquoi ça me fait peur. De devenir une autre personne, ou que les personnes autour deviennent d’autres personnes.
XG : C’est d’ailleurs beaucoup plus sensible dans Au recommencement,, il y a un côté beaucoup plus viscéral — L’humanité moins un est très construit, très intellectuel, un côté très philosophe et détaché. Au recommencement, est beaucoup plus sur l’onirisme, sur la paranoïa aussi. Ca m’a évoqué aussi Brazil, en particulier la fin où l’on se rend compte qu’il y a toute une partie du film qui relève du délire et qui est un mensonge.
TG : Oui, je ne sais pas si — c’est pas vraiment ça, ce n’est pas le fait de «est-ce que c’est le rêve, ou est-ce que c’est le réel ?» qui me fait peur. En fait, pour Au recommencement,, je voulais plutôt suivre un personnage et de mettre en lui différentes peurs que j’avais. Au recommencement,, c’était plutôt toutes mes idées, je mettais plein de trucs… Mais les deux livres ont été écrits plus ou moins en improvisant. Je savais comment ça se terminerait, plus ou moins, et puis après je faisais au fur et à mesure. C’était de l’improvisation, donc ça dépendait vraiment des mois, des périodes de ma vie. Donc oui, il y avait des mois où j’étais plus dans des trucs autour du rêve, donc je faisais plutôt ça. Et d’autres fois j’étais déprimé, je faisais des passages déprimants… En aucun cas il n’y avait un découpage hyper précis de tout.
XG : Justement, pourquoi ce titre, Au recommencement, avec la virgule après ? J’ai vu sur ton blog que tu avais considéré plusieurs titres.
TG : Je trouvais ça — j’avais l’impression que c’était un titre que l’on pouvait comprendre à la fin, c’est une nouvelle genèse, et donc il y a «au commencement», et là c’est un autre monde, puisqu’il y a un autre monde qui s’annonce, et donc c’était «au recommencement,». Et je trouvais que ça sonnait bien.
XG : Quels étaient les autres titres envisagés ?
TG : «Les machines», et «La peur» — je voulais un titre assez simple au début. «La peur», «La ville», «Les machines»… ou … je ne sais plus.
XG : Et comment t’est venue l’idée de passer de la démarche très cérébrale de L’humanité moins un, à mettre un petit peu tes angoisses dans Au recommencement, ? Même si tu dis que les deux ont été improvisées au fil du temps, il y a quand même deux directions qui sont très différentes.
TG : Il s’est passé quatre ans, entre. C’est par rapport à, je ne sais pas, à mes lectures et à ce que j’ai vécu. Je ne sais pas trop. En fait, ce sont des choses qui m’intéressaient quand je faisais L’humanité moins un, et je suis devenu plus modeste parce que j’ai l’impression d’avoir raconté pas mal de salades dans L’humanité moins un. C’est aussi un peu grâce à ou à cause des études de philo que j’ai faites, de vraiment faire attention à ce qu’on dit, et maintenant, si je ne connais pas trop un sujet, j’ose moins en parler. Alors qu’avant, je pouvais… je pouvais me permettre. Pour L’humanité moins un, des trucs sur la théorie du jeu, des choses qui m’intéressaient à l’époque, et je trouve moins bien maintenant. Ou des trucs de psychologie sociale que j’avais survolés vaguement à l’époque, et que maintenant j’aime moins. Je trouve que c’est moins valide. J’ai voulu faire un truc plus modeste, peut-être — moins crâner que pour mon premier bouquin.
XG : Pourtant, la structure de L’humanité moins un qui fonctionne sur l’idée d’une enquête, d’essayer de trouver un coupable à partir de déduction, c’est une structure qu’on appréhende très rapidement et qui pousse le lecteur à avancer. Dans Au recommencement, c’est beaucoup plus déroutant encore. Tu parles de quelque chose de plus modeste, mais au final cela demande plus d’effort de la part du lecteur.
TG : Oui, c’est vrai. En fait, je voulais faire un récit où l’on suivait un personnage, même si effectivement parfois on va voir d’autres personnes. Où le personnage était plus important, alors que L’humanité moins un, c’est la structure qui est importante. Et là, j’ai décidé qu’il fallait plus s’intéresser au personnage. Tout en essayant de ne pas faire de psychologie, parce que je n’aime pas trop.
XG : J’ai trouvé un autre écho entre les deux livres — peut-être que j’essaie trop d’analyser. Mais dans L’humanité moins un, tu parles d’«un amas de matière inerte, parvenu à un stade donné d’agglomération ou d’évolution si vous préférez, l’être humain». Et après, tu nous proposes un personnage qui a des échos avec la ville, qui s’appelle «Machine», et que également, il y a ce personnage qui répète que son corps, c’est le monde.
TG : Ah oui. Pour Au recommencement, j’avais pensé à ça. Au fur et à mesure que j’avançais, j’avais l’impression que, vu que son visage c’était l’univers, il y avait plein de choses que je pouvais ramener au corps. Mais pas vraiment pour L’humanité moins un.
XG : C’était plus pour réagir sur la phrase et la connexion. Il y a vraiment du viscéral dans Au recommencement, il y a vraiment une présence du corps qui est plus marquée. Même si dans ton dessin, le corps reste toujours «malaxé» dans l’approche.
TG : Oui, mais j’avais envie qu’il y ait plus d’idée de mouvement, presque cinématographique. Parce que sinon, mes autres bandes dessinées, ce n’étaient que des mecs qui parlaient et là, j’avais envie que d’autres éléments du corps entre en compte, que ça fasse partie de l’histoire.
XG : D’ailleurs, ça ressort beaucoup lorsqu’il y a ces gros plans sur le pied, sur la jambe… Tu disais, c’est suivre un seul personnage, en même temps il y a pas mal de digression dans le livre, puisqu’il y a des moments où le fils va jouer et transforme les choses d’un coup de baguette magique, il y a bien sûr tous les passages avec Abel où Machine n’est pas présente…
TG : C’est vrai, ce sont des digressions, mais c’est avec sa famille, ou des choses qu’elle entend. Mais j’étais obligé de faire des digressions, je me sentais obligé de faire ça.
XG : C’est donc vraiment un projet que tu as géré à l’intuition, au fur et à mesure ?
TG : Oui, ce personnage dont le visage est l’univers, c’est un vieux truc. J’avais commencé à faire des strips, mais ça ne me plaisait plus trop de faire ça. Et je voulais l’inclure dans cette histoire — c’est souvent comme ça, j’ai deux idées, j’essaye d’avoir deux idées, et avec ces deux idées je fais une histoire en tirant le plus possible une idée vers l’autre. Et l’histoire, c’est juste les liens. Parfois, les idées ont disparu. Il devait y avoir d’autres éléments normalement, je voulais qu’il y ait — l’idée de Au recommencement, à un moment, il devait y avoir un meurtre. Et puis en fait, ça a changé au fur et à mesure. Donc oui, je pars en général — il y a un début que j’aime bien, et un sujet … oui, c’est un sujet dont j’ai envie de parler, enfin, une thématique. Et puis je connais la fin, j’essaie de trouver la fin, et ensuite j’improvise. Et c’est pour ça que ça met du temps, aussi. Parce que c’est écrit au fur et à mesure. Je fais quelques pages, et après je réfléchis. Et puis je refais quelques pages, et puis j’arrête. Mais souvent, les idées viennent au fur et à mesure du projet.
XG : Et là, tu es déjà en train de travailler sur un nouveau projet ? Ou fais-tu une pause en attendant que les idées reviennent ?
TG : Non non, pendant je faisais Au recommencement, je travaillais sur deux autres projets. Et là, j’en fais un — j’écris pour un dessinateur, François Henninger qui a fait Cent mètres carrés, chez Warum. Et là, ce sera vraiment sur le corps, pour le coup.
XG : C’est différent de travailler sur un scénario pour quelqu’un d’autre, par rapport à quelque chose que tu illustrerais toi-même ?
TG : Oui, parce que pour moi, les idées viennent au fur et à mesure que je dessine. Et là, vu que je ne dessine plus, c’est un peu dans l’abstrait.
XG : Tu fonctionnes comment, avec lui ? Tu lui envoies des morceaux, il te renvoie des morceaux ? Ou as-tu dû ficeler tout un scénario avant qu’il ne travaille dessus ?
TG : Là, j’avais fait les 24h de la bande dessinée l’année dernière, donc il fallait faire 24 pages. Et j’avais bâclé un truc, et ça je le reprends et je le réécris pour notre scénario. Donc il a déjà une idée, et ce serait la première partie. Et je réécris donc, quatre pages par quatre pages, de temps en temps. Et ça, c’est un truc vraiment sur le corps, c’est sur des aristocrates anglais, c’est pendant la guerre froide, c’est sur le corps — il y a des conflits, c’est sur des espions anglais qui travaillaient pour les russes. Ils étaient homosexuels — enfin, pas tous, mais il y en avait trois. Et je voulais travailler sur le corps aristocrate et le corps du travailleur. Donc il y aura du sexe et pas mal de comparaisons.
XG : Et ton deuxième projet ? C’est quelque chose que tu illustres toi-même ?
TG : Oui, c’est un récit historique, là c’est super compliqué. Ce n’est pas du tout ma façon de penser habituelle, il faut que je trouve une autre façon de penser. C’est à partir de personnes qui ont vraiment existé — ce sera un peu absurde aussi, mais j’ai envie que ce soit … parce que ce sont des personnes politiques importantes. C’est un type des Black Panthers, et Timothy Leary, et puis c’est un contexte aussi. Et donc là, je travaille sur ça, oui. Là, je vais peut-être écrire une structure plus précise avant de commencer à dessiner.
XG : Par rapport à ton idée d’éviter d’écrire sur des choses que tu ne connais pas bien, ce serait te lancer un défi de plus ?
TG : Oui, en fait j’aime bien. C’est une bonne contrainte pour lire des livres ou s’intéresser à des choses, c’est dire — bon, j’ai envie de parler de ça, je suis obligé de me renseigner un peu. J’ai fait des histoires courtes, une en dodécasyllabes, une en alexandrins, et je ne savais pas comment faire. Donc je me suis intéressé à la versification, la méthode et la forme. J’ai l’impression d’être un dilettante, en fait, je connais à peine chaque sujet. Et la bande dessinée, ça me permet de me pencher sur certains sujets.
[Entretien réalisé durant le Festival d’Angoulême, le 30 Janvier 2009.]
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée

 Au recommencement,
Au recommencement,
 L’ Humanité moins Un
L’ Humanité moins Un














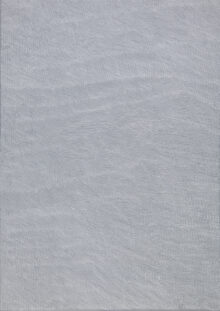











An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster