Lorenzo Mattotti
Dans le calme de son atelier parisien, l’amour de Lorenzo Mattotti pour la peinture imprègne les lieux. À côté du plan de travail, une imposante bibliothèque révèle les peintres qu’il affectionne : Bacon bien sûr mais Hopper, Dubuffet, Miro, les expressionnistes… ses rayonnages dégagent cette passion pour le beau livre et la puissance de son contenu.
Sur une petite table attenante, quelques carnets de croquis restent à proximité. Ce sont des essais libres à l’encre de couleur, l’écriture automatique de Lorenzo à l’image des peintres, car Lorenzo Mattotti fait aussi de la peinture. Des toiles imposantes qui n’ont pas encore reçu leur moment d’achèvement sont dressées dans une lumineuse pièce blanche à côté de l’atelier. Aux murs, quelques esquisses d’une illustration — une commande pour le supplément littéraire d’un quotidien national. Il ne reste plus rien de Stigmates sur les murs, et aucune planche n’est encore accrochée de la dernière œuvre de Lorenzo. Un livre magnifique inspiré d’une première version courte publiée dans le collectif Le retour de Dieu chez Autrement. L’histoire est ce long cheminement à travers la surdité et l’autodestruction d’un marginal, pour sortir de sa vie qui n’a été qu’une forêt aride et confuse. Etonnant que ce chef-d’œuvre (de l’importance de Feux) dessiné à coups de griffes, d’épines, de gribouillis soit absent des nommés pour les différents Alph’Art du festival d’Angoulême 99.
L’Indispensable : Le thème sur le sacré, sur la religion, sur sa violence, est bien sûr le thème de Stigmates. Vos origines italiennes ont-elles beaucoup joué, l’idée du sacré en Italie ayant une intensité particulière ?
Lorenzo Mattotti : Pour Claudio Piersanti et moi-même, cela fait partie de notre culture. Nous avons travaillé avec des références de notre pays, de notre religion, mais, je crois, d’une façon laïque. Nous avons pris des éléments des mythes de notre imaginaire, de notre culture pour développer une histoire actuelle. Nous pouvions très bien jouer avec le baroque de la religion (comme les prêtres) mais cela ne nous intéressait pas. Il y a des mystères dans toutes les religions, et la religion est la façon d’expliquer ces mystères.
Pour nous, cette idée de mystères, de phénomènes étranges qui partent d’une autre dimension, nous a permis de raconter une histoire qui est la conquête d’une prise en charge de soi-même : voir ce qu’est la réalité et cesser de se la cacher à soi-même. Je crois que l’idée de se prendre en charge est un sentiment intérieur. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous savez que vous devez le faire. Vous savez qu’il est possible de le faire… mais vous ne voulez pas l’accepter parce que vous savez que si vous le faites, ce sera fatiguant, ce sera très dur de briser les murs de vos défenses intérieures. C’est un problème que nous nous cachons constamment parce que ça nous fait tout simplement chier.
L’I. : Cette atmosphère religieuse était très présente dans votre jeunesse ?
L. M. : J’ai servi la messe. Mes frères et moi, nous étions toujours à la paroisse. C’était un centre social, un endroit où nous, garçons, nous rencontrions d’autres garçons. Nous jouions tout le temps. Nous faisions de grandes promenades. Il y avait des gens très pauvres et nous nous mélangions beaucoup les uns aux autres. En Italie, une des plus fortes organisations sociales est bien évidemment l’Eglise. Nous l’avons même vécu comme un lieu social jusqu’à l’âge de 12 ou 13 ans. Par la suite, nous avons naturellement tous grandi et beaucoup changé. Je crois qu’une très grande part de mon imaginaire, la partie idéaliste, visionnaire de ma vie, mais aussi un côté dramatique, sont issus de cette culture religieuse.
L’I. : Vous combattez ce pouvoir de l’Eglise, puisque le personnage de votre livre cache ses stigmates à la fin du récit. La partie religieuse disparaît donc, tout en préservant finalement l’idée du sacré…
L. M. : Un jour, j’ai vu dans une émission sur la religion, une vieille femme qui avait des stigmates. Il apparaissait clairement cependant, que depuis sa naissance, elle était issue d’un milieu ayant une culture religieuse particulièrement importante. Le récit de Stigmates va donc contre ce genre de stéréotypes existant dans certaines cultures. Notre personnage est un ex-punk, un mec tatoué, aux idées très conformistes. Bien qu’en même temps il se foute de tout ! En cela, cette histoire m’intéresse. Dans notre récit, ce mec n’en a rien à faire de la religion, et pourtant, à un certain moment, il y trouve une réponse à ce qui le tourmente… mais une réponse qu’il ne veut pas voir, parce que cela l’ennuie profondément.
Ce qui m’attirait aussi dans cette histoire, c’est que ce personnage soit sauvé. Grâce à des mots qu’il lit et découvre dans un livre, il décide d’ouvrir sa fenêtre intérieure. Cela pouvait tout aussi bien être des mots à valeur mystique ou un simple conte. C’est important qu’il trouve dans un livre ce qui lui permette d’avoir le courage de cette prise en charge de lui-même. Cela peut arriver avec un livre, comme dans le cas présent, mais aussi avec la musique ou n’importe quel art.
L’I. : Apparemment, le thème lui-même est le fruit de discussions et d’idées qui évoluent. A quel moment votre choix (celui de travailler et de puiser dans la hachure) est-il arrivé ?
L. M. : C’est arrivé très naturellement après la réalisation de mon précédent récit L’arbre du penseur. J’hésitais à m’exprimer avec les hachures, parce qu’à cette époque, cela m’intéressait énormément de travailler au pinceau (ce que je n’ai jamais fait). Mais Stigmates amenait mon imaginaire graphique vers l’utilisation de traits. Ces traits, je les imaginais qui accrochent, secs, tendus, durs, et non doux et chaleureux comme ceux qui émanent du traitement au pinceau. J’étais encore très imprégné de l’univers de L’arbre du penseur tout en étant vraiment concentré sur la mise en place de Stigmates. L’histoire, ses personnages, ce que j’étais en train de dire, d’exprimer au travers de ce thème, m’intéressaient plus que le choix du traitement graphique.
Ce choix, pour sa part, est arrivé tout naturellement. Je voulais employer un noir et blanc très direct, mais qui devait cependant être assez travaillé. J’aime être direct avec ce que j’ai envie d’exécuter tout de suite, ce que je désire créer dans l’immédiat. C’est comme une sorte d’écriture. C’est pour cette raison que le rendu graphique du noir et du blanc m’intéresse beaucoup. En effet, il garde toujours cette relation à l’écriture. Je me demande ainsi souvent : «Mais qu’est-ce que je suis en train de dessiner, qu’est-ce que je suis en train de raconter ?».
Pour Stigmates, j’étais très concentré sur la narration, afin que l’histoire soit toujours très lisible pour les lecteurs. Même si le récit est en soi dramatique, il doit toujours garder cette lisibilité, cette linéarité. Ce récit devait par nécessité être très linéaire. Par ailleurs, se concentrer sur cette linéarité est un effort plus intellectuel pour un auteur, que lorsqu’il se contente, se félicite de dessiner de beaux très dessins… de très beaux dessins où il risque de ne pas s’apercevoir que l’histoire faiblit.
Pour ma part, je suis resté très concentré sur le rythme de l’histoire. Pendant la réalisation de Stigmates, j’avais toujours la totalité de mes planches à portée de vue, accrochées sur le mur. Je les regardais afin de vérifier qu’il ne s’y retrouve pas de sautes de rythme, d’intensité, dans la narration.
L’I. : Vous affichez toujours toutes les pages déjà réalisées ?
L. M. : J’expose toujours mes pages, afin de ne pas les quitter des yeux. II faut toujours avoir l’idée de ce que l’on a fait avant parce que c’est l’histoire elle-même qui construit l’histoire. Je regarde vraiment le rythme des formes et des traits — les hachures, les formes, les visages et la façon de vivre des personnages, l’atmosphère dans laquelle ils vivent leur histoire humaine…
Si je change, c’est parce que l’histoire doit être modifiée, parce que je le choisis. L’histoire est aussi une histoire de traits. Il y a parfois les traits qui changent. La plume peut-être parfois plus grosse, plus grande parce que ce n’est pas le même trait que je veux faire. Les traits mettent en place une émotion, installent les changements d’atmosphère. Ce n’est pas seulement fait par l’histoire. Si c’était le cas, ce ne serait pas la peine de la dessiner. Ce serait à l’écrivain de la faire. C’est toujours une question de contrôle. Si ça ne marche pas, c’est qu’il y a des problèmes, qu’il faut ajouter, couper, modifier l’équilibre.
L’I. : Quelle est la part de vous-même qui est dans le trait, dans le geste ?
L. M. : J’y suis toujours présent. Mais pour raconter l’histoire, il me faut imaginer les attitudes de mes personnages. Normalement, c’est un automatisme et l’image m’arrive déjà composée. J’essaie alors de la faire coïncider avec ce que j’ai dans la tête. Il y a toujours une ligne qui décrit. Dans Stigmates, à certains moments, j’aurais pu garder uniquement cette ligne et réaliser une bande dessinée très lisible, mais où tout manquerait. Raconter avec le dessin m’intéresse beaucoup.
Je suis plutôt un narrateur avec les traits, avec les couleurs. C’est là, ma façon naturelle de raconter. Ma personnalité se retrouve aussi dans ces petits changements sur l’évolution de la ligne, sur l’utilisation des blancs. Dans ce récit, j’ai constamment eu à l’esprit les petits changements dans les gris, dans l’intensité des hachures. Il y a toujours comme une grille qui parfois s’ouvre et parfois est complètement abrutie, noire. Mais c’est toujours du gris. Il n’y a pas de noir véritable. Il n’y a jamais de noir avec les hachures. Parfois, il y a de la douceur dans ce gris. Elle apparaît avec d’autres lignes, avec la profondeur, avec le changement d’intensité. La douceur ou les émotions sont toujours dans le gris. Les hachures ajoutent des lignes plus douces dans un contexte très dur. Elles adoucissent le dessin, c’est un moyen très sensible, nous pouvons tout dire si l’on est capable de lire. Le problème est, à mon avis, qu’il est de plus en plus difficile de savoir lire.
L’I. : Avez-vous commencé à dessiner, une fois que vous aviez terminé d’écrire le récit ou avez-vous commencé à dessiner en laissant la possibilité à l’histoire de se nourrir de ces premières pages ?
L. M. : Je suis incapable de dessiner une histoire qui est déjà toute écrite. Pour moi, cela m’est impossible. Je trouve que si je l’écris, l’histoire est déjà là, ce n’est plus la peine de la dessiner. J’estime qu’en développant l’histoire au fur et à mesure, il y a toujours une découverte et les images sortent quand l’histoire est en train de se faire.
L’énergie est beaucoup plus forte que lorsque je connais toute l’histoire et que je dois la mettre en images. Dans ce cas-là, quand je dessine, je vois que je ne m’amuse pas, que je m’ennuie beaucoup. Le dessin ne sort pas comme je le souhaiterais, il ne communique pas, il n’exprime pas… alors que pour moi c’est fondamental. En plus, Claudio et moi-même voulions vraiment être libres de développer l’histoire avec tout son rythme à elle et pas celui d’une idée déjà totalement écrite. Claudio a donc écrit les textes à la fin. Nous faisions des épisodes et nous ne savions pas vraiment qu’elle pouvait en être la longueur. Au départ, je croyais que l’histoire compterait quatre-vingts pages. Peu à peu, je voyais que ce n’était pas la bonne longueur. J’avais conscience que ce rythme n’était pas le bon rythme. Mais nous continuions, nous allongions la pagination.
Mettre les textes dans les cases est une autre difficulté. Qu’est-ce que cela signifie de mettre deux ou trois mots sur une image, et d’imposer un silence sur celle d’après ? Il s’agit en fait du bruit de l’image, et même de sa musique ! Il faut prendre du recul pour contrôler. Je dois contrôler mes rythmes de lecteur. Si ces rythmes marchent, j’ai alors l’impression que le lecteur de son côté, comprendra aussi mes rythmes. J’essaie de me positionner comme lecteur et ainsi, vérifier qu’il n’y ait pas d’étranges moments de silence dans la narration, que ce ne soit pas trop parlé… et que le lecteur regarde bien l’image.
L’I. : Est-ce que cela n’oblige pas a vous immerger dans l’histoire, comme un peintre s’immerge dans sa peinture ?
L. M. : Je crois que c’est beaucoup plus long. Je pense aussi que c’est beaucoup plus fatiguant. Mais attention ! je ne dis pas que la peinture c’est plus simple. Quand nous avons un long projet, une histoire, il faut être toujours concentré sur l’atmosphère et sur la tension entre une image et une autre. Cette tension en bande dessinée doit toujours être très forte.
Avec une peinture, la tension est bien évidemment plus limitée — car elle n’existe que le temps de faire cette peinture. Tu as fait cette peinture-là et après c’est terminé… ou alors, éventuellement, la peinture te donne d’autres images. Quand je réalise une longue histoire, j’ai cette histoire, j’ai le mouvement, j’ai le personnage principal de l’histoire qui vit toujours en moi. Pendant tout le temps, où je suis en train de la faire !
Parfois c’est très long. Pour exemple, je ne dis pas que je suis l’homme de Stigmates, mais il y a des moments où je comprends comment ce dernier bouge, comment il fait ses mouvements et, peu à peu, je me surprends à adopter sa façon de faire, adopter sa manière. Il y a une symbiose. Pour Feux, et pour d’autres histoires que j’ai faites, c’était ainsi : un long voyage avec ces personnages. Le personnage incarne, exprime, ce que vous savez que vous avez en vous-même. De ce fait, vous comprenez et constatez combien le récif concrétise cette dimension intérieure. Il y a donc la concrétisation de ce qui est en nous… c’est sûr !
L’I. : A ce stade de votre œuvre, Stigmates ne symbolise-t-il pas la propre lutte du dessin pour affirmer sa capacité à raconter ? Une lutte contre le scénario préalable, que la bande dessinée a érigé en système, et qui finalement étouffe la force narrative du dessin …
L. M. : Quand j’ai fait L’homme à la fenêtre, on m’a reproché un dessin simple et une approche littéraire. La simplicité est vraiment une démarche volontaire et je voulais seulement raconter cette histoire de cette façon. Avec Stigmates, j’ai vu comment récupérer toute cette puissance qui sourde dans ma nature. Une puissance d’évocation des traits, par le trait, que l’histoire m’a donné la possibilité et la capacité d’affronter. L’idée d’une histoire linéaire avec une structure où nous partons d’un point A pour arriver à un point B, m’a tout le temps permis de jouer avec la tradition de la bande dessinée. De plus, mon expérience avec l’expression du trait et de tous ces conflits, s’est affirmée naturellement pour cette histoire.
Il s’agit là encore (et toujours !) du mystère pour trouver les moyens justes et nécessaires pour raconter… et il arrive parfois — c’est d’ailleurs fascinant — que les traits racontent l’histoire dans un niveau narratif différent. C’est également arrivé pour le récit Feux. Toute mon expérience avec les crayons, avec les pastels gras, avec les pastels durs, toute l’expérience de découverte des moyens picturaux que j’étais en train d’utiliser est presque parallèle à l’histoire du soldat dans Feux. C’est justement ce qui donne la force à cette histoire. Si j’avais du faire Feux 2, le retour ou Feux, la vendetta, je n’aurais fait que jouer de (et avec) mon métier. Il n’y aurait jamais eu, et je ne l’aurais jamais connu, la merveille de découvrir ce que l’on est en train de raconter, et de raconter ce que l’on découvre. Cela apporte une énergie incroyable.
C’est également ainsi dans la peinture. Il y a des peintures qui, sans que nous sachions pourquoi, possèdent une dimension particulière. Cette dimension réside peut-être dans le moment exact où le peintre a fait une découverte. Ainsi, il est arrivé à dire : «C’est cela que je dois faire ! Et c’est cette découverte que je vous raconte». Par contre, la difficulté est de trouver la forme qui concrétise tout cela. Mais cette découverte n’est pas le fruit du hasard. Vous ne vous réveillez pas le matin en la découvrant comme par enchantement. Nous arrivons là, à tel endroit, parce que nous avons tout le temps cherché à l’atteindre. C’est une réelle conquête… et c’est ce qui est beau !
L’I. : Votre œuvre est cependant basée sur la collaboration avec des scénaristes. Que vous apporte-t-elle ?
L. M. : La collaboration est très importante pour moi. Grâce à elle, j’ai toujours la présence d’un échange, d’une écoute. Il est très important de pouvoir s’exprimer afin de comprendre l’évolution de son travail. Travailler seul sur mes propres histoires est une expérience fatigante. Je peux tomber dans des labyrinthes mentaux n’aidant en rien à développer les récits. Dans toutes les histoires que j’ai faites, comme Feux ou Le Signor Spartaco, les mots sont toujours liés au dessin. Je suis un émotionnel dans l’utilisation des mots, et je ne peux pas faire plus que ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui.
Il est donc essentiel qu’un écrivain, (qu’une personne que j’aime, surtout !), contrôlant les mots comme moi je contrôle les traits, s’associe à la création. L’écrivain choisit d’utiliser certains mots parce qu’il connaît la signification et l’usage de tous les autres… De mon côté, je choisis de faire un trait et pas un autre, parce qu’il me semble alors être le plus juste pour l’efficacité de l’histoire. Il faut toujours se donner la possibilité d’un choix.
L’I. : Les idées développées sont parfois très ambitieuses parce qu’on essaie de toucher des dimensions intérieures. Dans L’homme à la fenêtre, il y a un visage de femme représenté avec quelques traits, dans lesquels toute la tension des pages précédentes trouve son aboutissement. Votre œuvre semble avancer vers la symbiose du récit narratif et du récit graphique…
L. M. : Dans Stigmates, nous avons vraiment essayé d’atteindre cette symbiose, grâce, je crois, à la capacité de Claudio à raconter l’histoire de façon très simple et très profonde. Il insère de petits arguments dans le récit, des petits détails qui vous donnent, à la lecture, l’idée de la profondeur. Avec sa façon simple mais forte de raconter, associée à mon dessin, je crois que nous sommes arrivés au bout de ces choix. Cependant, ce n’est pas une règle.
Nous avons vraiment envie de travailler encore ensemble, pour une autre histoire, avec alors un autre style d’écriture et un autre traitement graphique. Feux, par exemple, possède un équilibre différent de celui de Stigmates, parce que la puissance propre des dessins de Feux doit être équilibrée d’une autre façon que celle que Claudio a apporté pour Stigmates.
Parfois, je suis très dur avec mes histoires lorsque j’ai l’impression que les bons rythmes ne sont pas trouvés. Le rythme narratif est très important pour maîtriser la notion du temps dans un récit… et le temps est rendu par la symbiose du mot et du dessin. Maîtriser tout cela est une conquête pour moi.
L’I. : Vous auriez pu sans problème connaître une carrière de peintre, et néanmoins, vous êtes énormément et particulièrement attaché à la bande dessinée…
L. M. : Le temps du récit, l’organisation des images en rapport avec les émotions qu’elles évoquent me fascine. Parfois, nous avons besoin de moments très lourds, très bizarres dans une narration. Je me souviens de certains films de Tarkovski où existaient ces moments lourds, ces moments fatigants. Seulement, si nous ne ressentions pas la fatigue nous n’arrivions pas à l’émotion. Cette fatigue est nécessaire au spectateur pour arriver à un certain moment de liberté et à un certain stade de totale légèreté. Ce qui m’intéresse dans la bande dessinée, c’est la longueur du récit, la gestion de ces moments particuliers… Parallèlement, me lancer dans une longue histoire en couleurs me fait assez peur.
L’I. : Par leur liberté de forme, de volume, de geste, vos personnages paraissent beaucoup plus issus de la peinture, que du réalisme du cinéma ou de la bande dessinée.
L. M. : Quand je dessine, je pense toujours aux sentiments réels. Des sentiments réels que, j’illustre par des formes irréelles. Mais je ne m’aperçois pas des déformations. Je ne les ai pas conçues exprès pour être pictural, mais bien pour exprimer mon idée personnelle du réel. Elles sont alors inévitables. L’émotion change les formes, et c’est ainsi qu’elle atteint son statut d’émotion réelle. Les dessins sont plus forts quand j’ai cette relation directe à la réalité. Je ne pense pas au jeu de formes, qui lui, s’exprime dans d’autres travaux comme mes croquis ou mon écriture automatique.
Ma picturalité est peut-être plus présente dans l’illustration, car l’illustration a des relations avec la peinture dans la tension et dans la concentration d’une image. Tous les éléments doivent être en tension pour raconter de façon très concentré sur plusieurs niveaux. J’ai l’impression qu’il y a des déformations d’espace plus fortes dans l’illustration, déformations d’espace, de relations avec les couleurs, pour toujours obtenir une efficacité dans la fascination de l’image.
La bande dessinée est plus détendue, plus ouverte et je visualise toujours les développements à venir. Elle est beaucoup plus liée à une réalité en mouvement. Je crois que c’est plus facile de donner un mouvement aux «images Stigmates», qu’a une série d’illustrations. Les illustrations ont une construction et une composition qui sont faites pour une approche bidimensionnelle et pour l’image arrêtée. Il est très compliqué d’essayer de la développer, de la mettre en forme dans l’espace et dans le temps.
L’I. : Parallèlement à la mise en place de Stigmates, vous avez fait pour un éditeur allemand, ce très beau livre où l’on retrouve le personnage du s.d.f.
L. M. : Je crois que j’avais déjà commencé mon Signatur 1 pendant la deuxième version de Stigmates et ce livre est un bestiaire de chiens de races. J’ai mis des clochards et des chiens et ce sont toujours des molosses, des chiens avec un pedigree. Ils ont tous leur ascendance, ils mangent des choses précises et sont très aristocrates. Tous les chiens sont tenus en laisse, il y a toujours un maître à côté.
L’I. : La couleur a été une espèce d’équilibre dans le chemin noir et blanc de Stigmates ?
L. M. : Ça, c’est l’idée de la dimension colorée du noir et blanc de Stigmates. C’est un des rares moments où une illustration est aussi peinture. Je l’ai les ai pourtant toujours séparé dans mon travail. A mon sens, mes illustrions ne sont pas vraiment de la peinture. Mais ici, avec Stigmates, peut-être qu’il existe une sorte de mélange entre les deux. En plus, c’était une année où je venais de réaliser uniquement des commandes (peut-être des bons travaux mais que des commandes). Avec Signatur j’aurais pu faire un livre plutôt dirigé vers la peinture mais c’est sorti plus simplement. J’ai tout fait en dix jours. J’avais vraiment envie de le faire. J’ai été très content de réussir à publier dans Le Monde toute la version en noir et blanc, toutes les images en noir et blanc. Ce que j’aime c’est que c’est très bien imprimé. C’est imprimé en sept couleurs et les rouges sont vraiment mes tons rouges. C’est très beau.
L’I. : C’est étonnant le rapport entre le silence des hommes et le bruit des chiens.
L. M. : J’y vois surtout ma relation avec Francis Bacon et Alberto Breccia. J’ai d’ailleurs dédié ce livre à Alberto comme une dette que j’avais envers lui. J’éprouve, aujourd’hui, encore et toujours, une fascination pour ces deux artistes. Je ne trouve pas que la force, la fascination de Bacon, soit présente dans la viande représentait, mais bel et bien dans les sujets qu’il choisissaient… Je crois que sa force réside plutôt dans le contrôle de la composition. J’aime peut être moins sa matière, mais je trouve que la force de sa peinture se réalise au travers de la composition, se fait par les vides plutôt que par la tension entre les vides et les couleurs. J’ai aimé les portraits qu’il a peint à la fin de sa vie. Ces peintures n’ont pratiquement plus de viande ni de déformations, et sont d’une très grande sensibilité, d’une très grande force. Passer sa vie et arriver à cette épure, c’est extraordinaire.
Propos recueillis par Bruno Canard. Précédemment publié dans L’Indispensable n°2, Octobre 1999.
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée

 Guirlanda
Guirlanda
 Les Aventures de Huckleberry Finn
Les Aventures de Huckleberry Finn
 Docteur Jekyll & Mister Hyde
Docteur Jekyll & Mister Hyde
 Le Bruit du Givre
Le Bruit du Givre
 Stigmates
Stigmates
 Lorenzo Mattotti
Lorenzo Mattotti

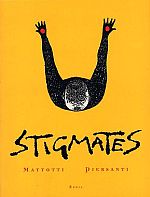
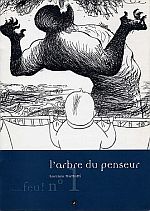





















An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster